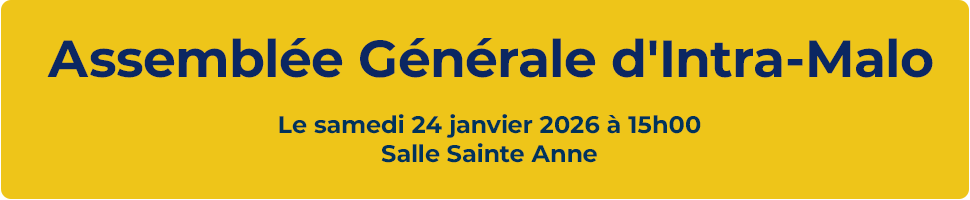Jean-Jacques ANNAUD est un cinéaste éclectique. La variété des sujets abordés dans ses films le démontre à l’évidence. La Victoire en chantant, Coup de tête, La Guerre du feu, L’Ours, Stalingrad… abordent en effet des thèmes très différents qui ont fait dire à de nombreux critiques qu’il était un « réalisateur touche-à-tout. » Mais un élément domine, selon moi, sa carrière de cinéaste ainsi que sa vie personnelle : l’élément religieux. Le Nom de la rose, Sept ans au Tibet, Notre-Dame brûle montrent son attirance pour le sacré, attirance qui a traversé sa vie. Lors d’une interview, il a confié à un journaliste :
« J’ai passé mon adolescence à photographier des cathédrales, des églises, des chapelles… Ce n’est pas tout-à-fait innocent si j’ai réalisé des films comme Le Nom de la rose, ou Sept ans au Tibet. Ce sont deux religions différentes, mais il y a le même sens du sacré. J’insiste, je suis athée, mais je crois en la nécessité d’une religion. Je crois en la solidarité, je crois en la tolérance et j’apprécie la foi des autres. »
D’où son enthousiasme immédiat pour le roman d’Umberto Ecco. A sa lecture, Annaud est subjugué et la possibilité d’en réaliser un « palimpseste » cinématographique s’impose à lui immédiatement. Tâche ardue, voire impossible, car beaucoup de professionnels considèrent l’adaptation à l’écran du Nom de la rose comme irréalisable.
Mais Annaud, contrairement à d’autres cinéastes, a des atouts non négligeables. Ses solides études classiques (huit ans de grec, six ans de latin), sa longue passion pour le Moyen âge font de cet érudit l’homme de la situation : il saura mettre en images l’imposant roman d’Umberto Ecco « à la croisée des langues, des mondes, des savoirs, des époques et des questions philosophiques qui déchiraient l’église catholique quant à l’interprétation des textes sacrés et le train de vie du clergé. »
Un point surtout fascine notre cinéaste : l’importance du rire donnée par l’auteur dans l’intrigue de son roman et qui va devenir le thème récurrent du film. Jean- Jacques Annaud précise :
« Qu’on puisse s’entretuer à propos d’un traité sur le rire a exercé sur moi un attrait irrésistible. Pourquoi est-ce si audacieux de défendre le rire ? Parce que le rire et subversif. Il détruit la peur du diable, de la mort et du châtiment, il engendre le pire, le blasphème. Rire, c’est abolir la crainte de Dieu qui est une des composantes de la foi – une position malheureusement toujours d’actualité chez les fondamentalistes de tous bords. »
L’accord entre le cinéaste et le romancier ne pose pas de problème : l’entente est rapide entre les deux hommes dès 1982. Mais de nombreuses embûches et un travail colossal attendent Jean-Jacques Annaud. D’abord avec l’élaboration du scenario : en effet, le livre ne se prête guère à l’écriture cinématographique, on l’a vu. Les différentes moutures proposées déçoivent le réalisateur. Il faudra deux ans et demi de travail et dix-sept versions successives pour parvenir à un résultat satisfaisant. Ensuite, avec les lieux de tournage et les décors. Annaud a visité près de trois cents abbayes, sans trouver l’endroit idéal. Finalement, le cinéaste ne retiendra que quelques salles de celles d’Eberbach et Maulbronn en Allemagne. Le chef décorateur, Dane Ferretti, prend alors l’affaire en main et va faire des miracles : il parvient à bâtir aux environs de Rome les extérieurs du monastère, chantier colossal qui mobilisera des centaines d’ouvriers, tandis que les célèbres studios de Cinecittà abriteront l’intérieur de la bibliothèque labyrinthique. Aucun détail de mise en scène n’est négligé : Annaud s’entoure de spécialistes chevronnés de l’époque médiévale – et notamment l’historien Jacques Le Goff – pour cerner au plus près la vérité historique et éviter les anachronismes (à l’exception toutefois de la statue de la Vierge à l’Enfant devant laquelle le jeune Adso de Melk se recueille, puisque son style est proche du milieu de la Renaissance.) Enfin, avec la production qui accumulera les péripéties. Le producteur français, Gérard Lebovici, qui a obtenu les droits de la RAI italienne, est assassiné au parking Foch à Paris en mars 1984. Alexandre Mnouchkine est contacté, mais il trouve le « projet trop cher et trop risqué. » Le réalisateur essaie alors de négocier avec d’autres partenaires (la 20th Century Fox, notamment) et c’est finalement le producteur allemand Bernd Eichinger qui acceptera de financer ce coûteux projet, malgré son opposition au choix de Sean Connery pour le rôle principal : il ne voulait pas miser de l’argent sur un acteur qu’il jugeait en déclin et trop associé au personnage de James Bond.
Les efforts – et les nombreuses émotions – de Jean-Jacques Annaud seront finalement couronnés de succès. Le film obtiendra un accueil enthousiaste au niveau mondial – sauf aux Etats-Unis – et collectera une recette totale de plus de 77 millions de dollars pour un budget de production estimé à 20 millions. En France, il réalisera près de 5 millions d’entrées et il obtiendra le César du meilleur film étranger en 1987. Sean Connery, quant à lui, sera récompensé par la BAFTA Awards 1988 en tant que meilleur acteur.
PLR