Rappelons de façon liminaire quelques précisions à propos du livre de Karen Blixen, un récit que le film de Gabriel Axel suit de près.
Sous le pseudonyme de Isak Dinesen, Blixen avait d’abord écrit sa nouvelle en anglais (Babette’s Feast, dans la revue américaine Ladies’ Home Journal en juin 1950). Le texte est repris tel quel dans le volume Anecdotes of Destiny en 1958.
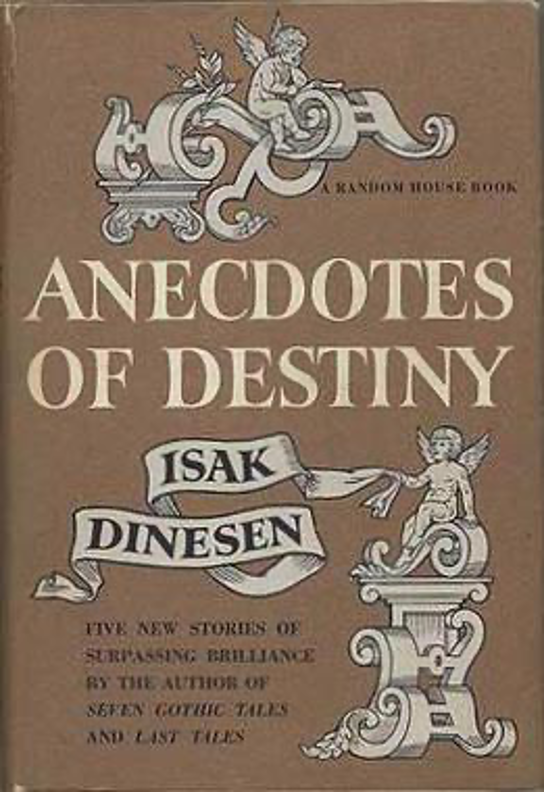
Une traduction danoise par Jørgen Claudi voit le jour deux ans plus tard, sous le titre Babettes Goestebud.
En 1958, une nouvelle version paraît en danois dans le recueil Anekdoter. Cette fois il s’agit d’une traduction faite par Karen Blixen elle-même, mais il s’agit aussi d’un texte modifié et allongé, nettement amélioré, dans sa langue maternelle. C’est cette version définitive qu’a traduite en français Alain Gnaedig.
Compte tenu de la brièveté du récit, on a pour coutume de parler d’une nouvelle. Mais le récit est aussi qualifié de « conte » ; en effet, son contenu est souvent plus proche d’une parabole que d’un récit réaliste.
Le cinéaste est resté fidèle au livre. Dans son film, toutefois, le milieu piétiste où se déroule le récit est un village du Jutland, région continentale du Danemark, tandis que la nouvelle de Karen Blixen situait ce lieu beaucoup plus loin, dans le Fjord de Berlevaag, à l’extrême-nord de la Norvège, un emplacement qui pose d’ailleurs problème puisque le personnage d’Achille Papin est censé quitter Stockholm, en Suède, et retourner à Paris en passant par Berlevaag – qui se trouve loin dans la direction opposée ( Le festin de Babette, p. 39). Gabriel Axel s’est éloigné de cette maladresse en situant le récit au Jutland.
À première vue, le sujet principal du film est perçu comme la confrontation d’une communauté piétiste au Danemark, dans le Jutland, avec l’art culinaire français, lequel fait appel à une sensualité volontairement ignorée par le mode de vie puritain. À l’issue du festin, la parole se desserre : tout le monde connaît les repas de famille où l’oncle Gustave, vieux grognon, se déride après quelques verres (surtout s’il s’agit de Clos Vougeot). C’est un peu ce qui se passe ici : le plaisir des sens tend à épanouir l’individu. Ce thème du film a évidemment fait son succès auprès du public français, puisqu’il flatte agréablement la fierté française en matière d’art culinaire. Comme on va pouvoir le développer par la suite, cette évocation positive d’une sensualité française rappelle la francophilie affirmée du père de Karen Blixen.
À ce thème se superpose un second sujet, qui est l’importance du don comme source de plaisir et comme qualité fondamentale de l’être humain. Le don est évidemment un thème d’une grande richesse, à commencer par la pratique ainsi qualifiée par l’anthropologue Marcel Mauss par rapport aux sociétés dites « primitives » (Essai sur le don, 1925) comme « fait social total », créateur des liens constitutifs de telles communautés. À la notion de don[1] comme comportement social généralisé a succédé à diverses époques une approche réduite à la morale, par opposition aux pratiques effectives qui s’en étaient éloignées, comme dans L’éthique à Nicomaque d’Aristote ou dans la Somme théologique de Thomas d’Aquin[2]. A cet égard, l’histoire de Babette révèle une gradation notable : les deux sœurs Martine et Philippa pratiquent le don sous forme de charité, à une modeste échelle quotidienne, tandis que Babette va réaliser une dépense somptueuse ponctuelle, évoquant l’ancienne pratique du potlatch chez les Amérindiens de la côté nord-ouest des États-Unis (une dépense dont on n’attend aucun profit, accomplie pour la gloire du donateur, et qui s’effectue comme une consumation sacrificielle)[3]. On peut également évoquer la tradition des agapes issues du paléochristianisme et de cérémonies analogues dans d’autres ères culturelles, où le partage de la nourriture est de nature à souder une communauté, et spécifiquement une fraternité incluant les pauvres (dans des sociétés socialement clivées)[4].
S’agissant de ces deux thèmes, la gastronomie et le don, il n’est pas question de sujets abstraits, produits d’une recherche intellectuelle, mais bien plutôt de motifs d’importance issus de l’expérience biographique de Blixen. En effet, la petite Karen avait entretenu des rapports très étroits avec son père, une personnalité hors du commun, et il n’y a pas lieu de douter que les fréquentes conversations entre la petite fille et son père avaient planté le décor pour l’évolution ultérieure de ses interrogations. Quand un enfant a eu la chance d’avoir un père (ou une mère) de cette dimension, exercer sa propre intelligence sera toujours, aussi, une évocation de la personne disparue.
Mais la question reste de savoir pourquoi Karen Blixen a construit ce récit tout à fait insolite d’une communauté piétiste d’un petit village du Jutland rencontrant tout d’un coup l’irruption d’une française, cuisinière et communarde. Ce récit, en vérité, est tout à fait énigmatique… sauf si on creuse un peu la biographie de Karen Blixen. Et, en effet, un troisième thème s’impose, montrant de façon plus précise qu’il est impossible de comprendre le récit du Festin de Babette sans y détecter d’importantes réminiscences de Wilhelm Dinesen, le père de l’écrivaine[5]. Ce troisième thème surgit de façon inattendue, discrète mais récurrente dans l’histoire de Babette, et il va s’avérer étroitement lié à la Commune de Paris. Que diable vient faire ce drame historique français dans un petit village danois ? À plusieurs reprises, la Commune de Paris émerge dans le récit de Karen Blixen, sans aucun lien apparent avec le lieu de l’intrigue, un sujet « importé » par le passé de Babette et que nous essaierons dans ce qui suit d’aborder comme toile de fond du récit. On pourrait aussi s’inspirer de la terminologie freudienne et dire qu’au-delà du contenu manifeste du récit, il existe un contenu latent qu’il faut reconstituer pour comprendre l’ensemble. Sans cette toile de fond, le surgissement d’une Communarde exilée dans un village perdu du Jutland resterait insolite, voire incompréhensible.
S’agissant du père de Karen Blixen, Wilhelm Dinesen, voici un très bref résumé de sa biographie qui sera utile pour la compréhension de la suite :
« Lorsque la France et la Prusse entrent en guerre en 1870, Dinesen démissionne de l’armée danoise et s’engage dans l’armée française pour en découdre contre les Prussiens. Il devient capitaine de la18ebrigade, mais il combat malheureusement dans une armée qui va de défaite en défaite. Il est dégoûté ensuite des luttes fratricides de la Commune, bien que sa sympathie ne soit pas en faveur des Versaillais. C’est alors qu’il devint le témoin, un peu distant d’abord, puis chaque jour un peu plus engagé, du printemps tragique et de la « semaine sanglante ». Quelques jours après la fin des combats, « las de corps et d’âme » il rentre à Katholm pour pleurer Agnès [une cousine dont il était amoureux] et part pour Québec et les États-Uniscinq mois plus tard. Il voyage à Chicago et dans le Nebraska, travaille chez un négociant en grains, et au cadastre, participe à des expéditions de chasse et parvient à bien connaître le mode de vie des Indiens. Il achète une cabane de rondins qu’il nomme Frydenlunden pleine forêt du Wisconsin et passe plusieurs mois à chasser dans la solitude. Les Indiens Chippawa lui donnent le nom de « Noisette », Boganis dans leur langue, qu’il choisira comme nom de plume. Il est proche des Indiens et dénonce les expropriations, les humiliations et d’une manière générale la disparition de leurs coutumes infligée par la civilisation. Comme sa fille plus tard en Afrique, il est témoin de la vulgarité du colonialisme (américain ici). Il est rappelé à Katholm en 1874, sa mère se mourant. Au Danemark, il se heurte à son père qu’il considère comme ayant des idées réactionnaires et se détache de son milieu. » (https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Dinesen).
Ou, pour reprendre ses propres termes : « … après avoir été témoin de la guerre civile à Paris, je suis retourné au Danemark et j’ai écrit ce livre que, sur les instances de quelques amis, je me suis résolu à publier.[6] Mais je me sentais épuisé, sans force ni courage, et j’aspirais au calme et à un travail physique afin de retrouver mon équilibre ; pour cette raison , je me décidais à fuir la civilisation. Je me rendis en Amérique du Nord et vécus quelques années dans la forêt vierge, en un lieu où aucun homme blanc n’avait auparavant habité et où ne passaient que des Indiens nomades […] j’ai passé plus d’un trimestre sans rencontrer âme qui vive. » (Préface à Paris sous la Commune, p. 60).
La Commune de Paris
Comme on peut imaginer, la présence du père de Karen Blixen pendant la Commune l’avait profondément marqué (voir sur notre site Intra-Malo la contribution consacrée à la biographie détaillée de Wilhelm Dinesen), et sa fille n’a pas manqué de centrer son récit autour de ce souvenir paternel.
Dans la lettre par laquelle Papin recommande Babette aux deux sœurs, il écrit : « La malheureuse qui vous remet cette lettre, Madame Babette Hersant, a dû s’enfuir de Paris, comme ma belle impératrice[7]. La terrible guerre civile a fait rage dans nos rues, et des mains françaises ont fait couler du sang français ! Les nobles Communards, ces hérauts de la justice et défenseurs des droits de l’homme, ont été écrasés et anéantis. Le mari et le fils de Madame Hersant, tous deux coiffeurs éminents, ont été abattus comme des rats. Elle-même a été arrêtée comme pétroleuse (un mot qui sert ici à qualifier les femmes qui ont mis le feu à des maisons avec du pétrole), et n’a échappé que de justesse aux mains sanglantes du général de Galliffet. Elle a perdu tout ce qu’elle possédait et n’ose rester en France ! » (Le Festin de Babette, p. 43).
L’ensemble du récit s’éloigne de ce thème jusqu’à ce qu’il ressurgisse à la fin, quand Babette, grisée par son festin réussi, rompt son silence habituel et confirme aux deux sœurs Philippa et Martine qu’elle fut une pétroleuse. Nous y reviendrons ci-dessous au paragraphe consacré au personnage de Babette.
Le Café anglais
Le Café Anglais est cité à trois reprises dans le conte de Karen Blixen :
· dans la rêverie d’Achille Papin au sujet d’un succès parisien pour Martine : « Quand elle sortirait de l’Opéra au bras de son mentor, les messieurs dételleraient les chevaux de sa voiture pour la tirer eux-mêmes jusqu’au Café Anglais, où l’attendaient un souper exceptionnel et des convives aussi raffinés que choisis » (Le festin de Babette, p. 41),
· dans le récit par le général Loewenhielm d’un dîner parisien organisé par le général Galliffet, auquel il avait été invité,
· dans le récit final de Babette en personne, où elle révèle avoir été chef cuisinier de ce célèbre restaurant.
Il est à peu près certain que le père de Karen Blixen, lors de son séjour à Paris, avait lui-même fréquenté cette table en compagnie d’autres officiers de haut rang, qui se trouvait au 13, boulevard des Italiens. Comme le rappelle la fiche Wikipedia : « Dugléré y créa le potage Germiny et les pommes Anna pour Anne Deslions, célèbre courtisane du Second Empire. Il composa aussi le menu du fameux dîner dit des Trois Empereurs, qui réunit à Paris le tsar Alexandre II, le tsarévitch Alexandre, le roi de Prusse Guillaume Ier et Bismarck, lors de l’Exposition universelle de 1867. À la fin du Second Empire, le Café Anglais était le plus snob de tous les cafés et le plus couru dans toute l’Europe. »[8].
De sorte que d’une certaine façon, tous les chemins semblent mener à ce restaurant prestigieux, où se sont croisés ou rencontrés plusieurs personnages réels et fictifs (le père de Karen Blixen, Achille Papin, le général Loewenhielm, Babette Hersant, le général Galliffet) …
Le général Galliffet
Babette, qui avait un passé de chef cuisinier dans un restaurant parisien très réputé, Le café anglais, avait dû quitter Paris, et même la France, à l’issue de l’épisode historique de la Commune de Paris en 1871. La lettre envoyée par Achille Papin relate en effet que Babette avait été communarde, et qu’elle avait échappé de justesse à la répression sanglante organisée par le général Galliffet, celui qu’on avait surnommé « Le marquis aux talons rouges » ou encore « Le massacreur de la Commune »[9].
Le général Galliffet est évoqué deux autres fois dans le film, de façon quasi-antinomique : d’une part il est cité comme étant le massacreur qui a fait fuir Babette, mais d’autre part il est aussi indiqué dans un autre contexte : le sympathique Lorens Löwenhielm, jeune officier de cavalerie suédois, amoureux éconduit de Martina, devenu par la suite attaché diplomatique à Paris puis général au Danemark, avait participé à un somptueux repas offert au Café anglais par le général Galliffet. Ce dernier, dont on sait qu’il menait grand train, bénéficiait ainsi du talent de celle qui allait devoir s’exiler pour lui échapper. « Le général Loewenhielm cessa net de manger et resta immobile sur son siège. Une fois encore, il se sentit transporté à ce dîner à Paris auquel il avait songé dans le traîneau. Un plat extraordinairement recherché et exquis venait d’être servi, et il en avait demandé le nom à son voisin de table, le colonel de Galliffet, qui lui avait répondu qu’il s’agissait de cailles en sarcophage. Le colonel avait ajouté que ce plat était une spécialité du restaurant où ils dînaient, et qu’il avait été inventé par le chef cuisinier du lieu. Bien que, chose fort ahurissante, ce cuisinier fût une femme, on le tenait dans tout Paris pour le plus grand génie culinaire de son temps. « En vérité, poursuivit le colonel de Galliffet, cette femme est capable de transformer le moindre repas servi au Café Anglais en une sorte d’affaire d’amour, une relation amoureuse éthérée et romantique où l’on ne sait plus faire la part entre l’appétit physique et l’appétit spirituel, voire entre la satiété et la plénitude. De ma vie, je me suis battu plus d’une fois en duel pour une belle dame, mais, voyez-vous, mon jeune ami, il n’y a pas une femme à Paris pour laquelle je serais plus disposé à verser mon sang !« ». Ironie bien macabre : c’est le sang de Babette qu’il s’apprêtera à verser, et non le sien…
On rapporte de Galliffet qu’il s’octroyait un droit de vie ou de mort ; selon son bon plaisir, qu’il « prélevait » sur les convois de prisonniers la dime du sang. « Ses victimes étaient choisies de préférence parmi les vieillards ou les blessés » (Maurice Dommanget, La Commune, Éditions La Taupe, 1971). Georges Clémenceau dira de lui : « Galliffet n’a pas fusillé de prisonniers depuis plus de vingt ans… Monotone, la vie. » (Jean-Noël Jeanneney, Clémenceau : portrait d’un homme libre, éditions Mengès, 2005).
Rappelons le nombre de morts officiel de la « Semaine sanglante » qui dura du 21 au 28 mai : les estimations oscillent entre 15.000 et 30.000 morts. Les femmes, les enfants, les malades et les vieillards sont exécutés jusque dans les hôpitaux. L’historien Jacques Rougerie précise que « ces exactions sont d’abord le fait des généraux bonapartistes ou monarchistes comme Ernest Courtot de Cissey, Joseph Vinoy et Félix Douay, ou de leurs subordonnées comme Gaston de Galliffet, alors que les massacres sont presque inexistants lors des opérations menées dans le nord de la capitale par le général républicain Justin Clinchant ».
Le personnage de Babette
Comme Wilhelm Dinesen, Babette vivra en exil intérieur, gardant ses secrets. « Babette parlait rarement de son passé. Au début, quand les deux sœurs avaient exprimé leur compassion pour son malheur, elle avait affiché toute la dignité et tout le stoïcisme que Monsieur Papin avait mentionnés dans sa lettre. « Oui, que voulez-vous, mes petites dames ? se contentait-elle de dire en haussant les épaules. C’est le destin. » » (Le festin de Babette, p. 48).
« Dans ces instants-là, Martine et Philippa comprenaient que les profondeurs de l’âme de Babette recelaient des abîmes, et qu’il s’y cachait des souvenirs, des souffrances et des désirs dont elles ignoraient tout. Un léger frisson les parcourait, et il leur arrivait de penser, au fond de leurs cœurs : peut-être, après tout, avait-elle vraiment été une pétroleuse » (ibidem, p. 48).
« Babette était arrivée à cette porte quatorze ans plus tôt, fugitive pourchassée, presque consumée de chagrin et d’angoisse » (p. 34). Ou encore, comme l’écrit Blixen : « Babette était arrivée en ville affaiblie et aux abois, avec les yeux fous d’une bête traquée, mais dans son nouvel environnement amical et paisible, elle afficha bien vite l’apparence d’une servante respectable et hautement appréciée. Elle avait surgi comme une mendiante, elle se révéla conquérante. » (ibidem, p. 45)
Toujours discrète, Babette reste capable de renouer avec son ancien personnage : lorsque les sœurs refusent de la laisser financer le festin, « Babette fit un pas en avant. Il y avait quelque chose d’inquiétant dans ce mouvement, comme une vague qui se dresse soudain. Était-ce donc ainsi qu’elle s’était avancée, quatorze ans plus tôt, afin de planter le drapeau rouge sur une barricade ? » (Ibidem, p. 53).
A l’issue du festin, Babette « les dévisagea et dit : Autrefois, j’étais cuisinière au Café Anglais. »
Et elle ajouta[10] : « Je ne vais pas retourner à Paris. Que voulez-vous que je fasse à Paris ? Ils sont tous morts. Je les ai tous perdus, mesdames. Oui, ils sont tous morts. Le duc de Morny, le duc Decazes, le prince Narichkine, le général de Galliffet, Aurélien Scholl[11], Paul Daru, la princesse Pauline[12] ! Tous morts ! » (ibidem, p. 75). Ce à quoi Philippa répond avec pertinence : « Mais tous ces gens que tu as mentionnés, tous ces princes, tous ces grands seigneurs de Paris, tu les a combattus, de tes mains ! Tu étais une Communarde ! Le général dont tu parlais a fait fusiller ton mari et ton fils, Babette. Comment peux-tu pleurer ces gens ? ». Réponse de Babette : « Oui, j’étais une Communarde ! Oui, par le Seigneur et la sainte Vierge, j’étais une Communarde ! Et les gens dont j’ai parlé étaient des êtres cruels et mauvais. Ils ont affamé le peuple de Paris, ils ont écrasé les pauvres, ils ont bafoué les lois, ils ont fait d’immenses torts à ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Oui, par le Seigneur et la sainte Vierge, je suis montée sur une barricade. J’ai chargé les fusils de mes hommes, mes bras étaient noirs de poudre, aussi noirs qu’aujourd’hui, par toute cette suie. J’ai pataugé dans le sang, mes bas en étaient trempés. Et pourtant, Mesdames, je ne vais pas rentrer à Paris maintenant que ces gens n’y sont plus. […] Voyez-vous, mesdames, ces gens m’appartenaient, ils étaient miens. Ils avaient été élevés – à un prix tellement pharamineux que vous ne serez jamais à même de saisir – et éduqués à comprendre à quel point je suis une grande artiste. Comprenez donc, mesdames, je pouvais les rendre heureux. Quand je donnais le meilleur de moi-même, j’étais en mesure de les rendre parfaitement heureux » (ibidem, p. 78).
Babette expose ainsi le point de vue de l’artiste : « Pour vous ? Non, j’ai fait cela pour moi. […] Je suis une grande artiste. […] Non, je ne serai jamais pauvre. Je vous le dis, je suis une grande artiste. Et une grande artiste, mesdames, n’est jamais pauvre. À nous, les grands artistes, il nous est donné une chose dont vous ignorez tout » (ibidem, p. 77). En effet, le don de l’artiste est avant tout un don à soi-même : l’un n’empêche pas l’autre, bien au contraire. Dans le cas de Babette, le don matériel à autrui est simultanément, et avant tout, un don moral (narcissique) à soi-même. Toutefois, dire qu’un artiste n’est jamais pauvre ne tend-il pas à effacer l’effrayante misère matérielle dans laquelle ont croupi tant de grands créateurs, peintres, musiciens, poètes ? L’époque contemporaine, qui connaît encore beaucoup d’artistes inconnus vivant dans la crainte du lendemain malgré le statut d’intermittent du spectacle, a néanmoins entrepris de liquider ce danger par le fait de multiplier à l’infini la marchandisation de l’art, un art devenant à ce point marchandise qu’en contemplant le produit, on retrouve effectivement la marchandise, mais beaucoup moins l’œuvre d’art.
Par ailleurs, l’idée que selon Babette « ces gens m’appartenaient, ils étaient miens » alors qu’il s’agissait d’ennemis mortels, jette quelque peu le trouble. Certes, cette « appropriation » datait d’avant la Commune, mais il est clair que la haute aristocratie et les grands financiers qui faisaient leurs ripailles au Café Anglais « n’appartenaient » d’aucune façon au personnel du restaurant, quels qu’en soient les talents culinaires. Tout au plus peut-on parler d’une fidélité de la clientèle à une très bonne table. Mais il est vrai qu’à cette époque, la renommée des artistes avait atteint des sommets. L’engouement frénétique pour des musiciens tels que Franz Liszt, Frédéric Chopin et Niccoló Paganini conférait un certain pouvoir à l’artiste qui, auparavant, n’avait été qu’un employé parmi d’autres au service des « grands », avant de figurer comme prophète ou comme sauveur à l’ère romantique. Richard Wagner en sera le paroxysme. C’est probablement ce thème qu’on retrouve dans les propos de Babette. Et il est vrai aussi qu’un grand chef gastronome peut légitimement revendiquer le titre d’artiste.
Simultanément, lorsque la Communarde Babette revendique une intimité avec ses clients « de la haute », on retrouve la même ambigüité chez Karen Blixen que lorsque Babette invoque, deux fois de suite, le Seigneur et la vierge Marie, ou lorsque Papin, sympathisant avec les Communards, parle de sa « belle impératrice » : le portrait semble quelque peu incohérent, comme si quelqu’un s’efforçait de parler une autre langue tout en continuant à s’exprimer dans la sienne.
Le général Loewenhielm
Ce personnage n’a pas seulement en commun avec Wilhelm Dinesen d’être un officier danois et d’avoir séjourné à Paris à l’époque de la Commune, il partage aussi avec le personnage paternel un certain mal de vivre. « Le général Loewenhielm avait obtenu de la vie tout ce à quoi il avait aspiré, et même plus encore. Il se trouvait dans une position assurée, reconnue et enviée. Lui seul connaissait ce fait incompréhensible et étrange, en contradiction avec sa réussite manifeste : il n’était pas heureux. Quelque part, quelque chose clochait. » (ibidem, p. 62). Blixen fait suivre de longs développements pour illustrer le sentiment de vanité ressenti par Loewenhielm. Et pendant le festin, celui-ci ressent « avec une arrogance mêlée de mélancolie : « Cela vaut-il la peine que je sois à cette table, ce soir ? Cela a-t-il un sens ? L’harmonie ne serait-elle pas plus parfaite sans ma présence ? » ». Il n’ira certes pas jusqu’à se suicider, à l’instar de Wilhelm Dinesen, mais les quelques lignes qui précèdent pouvaient très bien s’appliquer à ce dernier. Moyennant quoi cet officier danois ne manque pas d’évoquer un autre officier danois, Wilhelm Dinesen, dont il est en quelque sorte l’effigie dans un récit fictionnel.
Les évocations musicales
Alain Gnaedig relève que presque tous les textes des Sept contes gothiques mentionnent le livret de l’opéra – dramma giocoso – Don Giovanni, ossia il dissoluto punito (Don Juan, ou le dissolu puni, musique de Mozart et livret de Lorenzo da Ponte), notamment, dans le cas de Babette et à propos du chanteur d’opéra Achille Papin, le célèbre duo Là ci darem la mano, tentative ratée de séduire la servante Zerlina, amoureuse du jeune Masetto (« mi fa pietà Masetto »).
Cette évocation fréquente de l’opéra Don Giovanni se réfère au libertinage d’un aristocrate. Mais d’autres évocations musicales traversent la nouvelle de Karen Blixen.
Dans sa lettre à Philippa, Achille Papin écrit par exemple : « Et pourtant, ma Zerline perdue, mon cygne des neiges chantant, lorsque j’écris ces lignes, j’ai la certitude que le tombeau n’est pas la fin de tout. Au Paradis, j’entendrai de nouveau votre voix. Vous y chanterez, sans crainte ni scrupules, comme Dieu a toujours voulu que vous chantiez. Vous y serez l’immense artiste que Dieu vous a destinée à être. Ah, combien vous ravirez les anges ! » (Ibidem, p. 44).
Quand le soir du festin, à l’issue du repas, chacun rentre chez lui, l’atmosphère évoque « la musique des sphères » et « on croirait les étoiles plus proches » (ibidem, p. 73) : la musique des sphères est une très ancienne parabole, et elle recoupe indéniablement la vision poétique d’un ciel étoilé.
Le très ancien mythe (pythagoricien) d’une musique céleste imprègne le récit, transposé de la cosmologie antique à la vision chrétienne de l’au-delà. L’innocence quasi enfantine des deux sœurs, ainsi que les chorales régulières des fidèles forment une sorte d’anticipation de la vie éternelle dans la sérénité, sans aucun point commun avec le chef d’œuvre de Mozart. Ces cantiques veulent évoquer l’harmonie, mais du fait d’une conception exsangue de celle-ci, ils manquent de chair et réduisent le potentiel musical à une forme litanique (en dépit de la très belle voix de Martine) : n’est pas Jean-Sébastien Bach qui veut !
On peut aussi songer à une autre partition, celle du dernier mouvement de la quatrième symphonie de Gustav Mahler, un Lied accompagné par l’orchestre, intitulé Das himmlische Leben (La vie céleste). La volonté d’y affirmer un monde enfantin et innocent, thème qui parcourt d’ailleurs l’ensemble de la symphonie, et l’évocation explicite de la musicienne céleste, Sainte Marthe (« aucune musique n’est sur terre qui pourrait se comparer à la nôtre »), sont pourtant constamment contredites par des réminiscences profanes de leur contraire. L’épuration est entravée. Comme l’avait finement compris le philosophe, sociologue et compositeur Theodor W. Adorno, « la théologie de Mahler est, comme celle de Kafka, gnostique ; sa symphonie de contes enfantins est aussi triste que ses œuvres tardives. Lorsqu’elle se meurt après les paroles prometteuses « que tout s’éveille aux joies« , personne ne sait, si elle ne s’endort pas pour toujours. […] Aucune transcendance ne survit, hormis la nostalgie. » [13] Que faut-il en penser, à propos de notre village danois ? L’art de Babette aura-t-il suffi à opérer une transmutation durable ? Et les litanies réussiront-elles à devenir de l’art ? On est bien obligé d’en douter.
Assumer le passé
La question la plus subtile, voire retorse, soulevée par Le festin de Babette est sans nul doute de savoir comment assumer son passé comme s’il était resté ouvert.
Dans sa tentative de séduction, Don Juan tentait d’appâter Zerlina en lui promettant de changer sa vie(Io cangerò tua sorte). Ce passage semble avoir beaucoup marqué Blixen, et le récit de sa nouvelle tourne probablement autour de cette notion : peut-on changer sa vie, et doit-on changer sa vie ? Comme le disait à juste titre la petite paysanne Zerlina, « je peux encore me tromper » (Ma può burlarmi ancor).
Qu’en dit le personnage de Loewenhielm? « Oui, dans la vie, nous tremblons devant le choix que nous devons faire. Et après l’avoir fait, nous frémissons à l’idée d’avoir mal choisi […] Voyez, ce que nous avons choisi nous est donné, et ce que nous avons repoussé nous est accordé également, en même temps » (ibidem, p. 71).
Cette conclusion n’est-elle pas totalement contre-intuitive ? D’emblée, lorsqu’un dilemme s’offre à plusieurs personnages (aussi bien à Martina qu’à Philippa, à Achille Papin comme à Lorens Löwenhielm), la réponse de la part des quatre se présente comme un renoncement[14]. Au terme du renoncement réel se pose la question d’une survie psychique, à travers le temps, de la stimulation initiale malgré ce renoncement, une question qui peut facilement dériver vers une transposition métaphysique (le plus beau mais aussi le plus surprenant exemple cinématographique de cette question étant sans doute le film Peter Ibbetson tourné par Henry Hathaway en 1935 d’après une œuvre de George du Maurier, film adulé en son temps par les surréalistes).
Impossible de ne pas penser à ce chef d’œuvre insolite lorsque nous entendons Loewenhielm s’adresser à Martine :
– Loewenhielm, « J’ai été avec vous chaque jour de ma vie ! Dites-moi, vous le saviez aussi, n’est-ce pas ? ».
– Martine : « Oui, cher frère, je sais qu’il en a été ainsi ».
– Loewenhielm, « Et vous savez également que je serai toujours avec vous aussi longtemps que je vivrai. Chaque soir, je m’assiérai à votre table avec vous, comme ce soir, non pas en chair et en os, ce qui ne signifie rien, mais en esprit. Car ce soir, ma chère sœur, j’ai appris que, dans notre beau monde, tout est possible » (ibidem, p. 73).
Mais tout le possible fait-il réellement partie du monde ? N’en est-il pas la part abandonnée ? Quel est dans le monde le statut du possible, du virtuellement possible, face au réalisé ? C’est assurément une question que, généralement, on préfère éviter.
Pour autant, on se gardera d’y apporter une réponse présomptueuse. La réponse, précisément, est sans doute inséparable du vécu, et donc de la singularité de chacun. Chaque instant intervient comme s’il était un ensemble de portes ouvertes vers plusieurs chemins, et se décider équivaut généralement à en fermer une, ou plusieurs, au profit d’une seule. Ce qui n’implique pas, bien au contraire, que ce possible non réalisé cesse d’influer sur notre esprit, qu’il ne reste pas, d’une certaine façon, latent. Sous quelle forme ? Peut-on vivre plusieurs vies simultanément ? Peut-on raisonnablement regretter ce que, faute de l’avoir choisi, on n’a pas vu s’accomplir ? Mais, en réalité, s’agit-il de raisonner ? Ne sommes-nous pas plutôt dans le domaine d’un indécidable existentiel ?
Chez des auteurs tendant à l’ésotérisme, et donc tout à rebours du réalisme, la catégorie du « manifesté » n’est qu’une sous-catégorie du « non-manifesté ». Or Blixen n’est pas dépourvue d’une tendance un peu mystique, qui s’exprime par exemple ici :
« Ils se rappelaient seulement que la pièce avait été illuminée d’une clarté céleste, comme si une multitude de petites auréoles s’étaient rassemblées pour former une gloire splendide. De vieilles gens taciturnes reçurent le don des langues, des oreilles sourdes se débouchèrent. Le temps lui-même se confondit avec l’éternité. Les fenêtres de la maison resplendirent bien après minuit, et des chants se déversèrent à flots dans la nuit hivernale » (ibidem, p. 71). « Les illusions terrestres s’étaient dissipées sous leurs yeux comme de la fumée, et ils avaient vu le monde tel qu’il était réellement. Il leur avait été offert une heure du millénium » (ibidem, p. 72).
Cette impression d’un « instant d’éternité » (« oh temps, suspend ton vol », selon l’expression de Lamartine), personne sans doute n’y est étranger. Nous l’avons tous vécu, au moins une fois. Le bonheur, ce serait assurément de vivre cet instant de multiples fois. Mais rien ne peut être provoqué, seule compte la disponibilité à l’événement, l’ouverture au monde, toutes les qualités qui constituent la toile de fond de tout ce qui s’apparente au coup de foudre.
Toutefois, dans le contexte biographique de Karen Blixen, on peut aussi jeter une lumière différente sur le thème du possible. Son père, Wilhelm Dinesen, a vécu à plusieurs reprises le caractère impitoyable de l’échec : échec de la guerre danoise contre la Prusse, échec de la guerre française contre la Prusse, échec de la Commune de Paris, échec du destin des Amérindiens devant l’invasion yankee, échec d’une réconciliation personnelle avec son père et sa famille d’origine, très conservatrice… Dans toutes ces occasions, le possible souhaité n’a pas vu le jour, et l’échec est resté pesant – au point que Dinesen a fini par se suicider. L’esprit naïf d’ouverture, voire une propension mystique de Karen Blixen, n’était-ce pas là, à sa façon, une manière de renverser la vapeur, d’effacer l’accumulation tragique de la biographie paternelle, une volonté d’affirmer que malgré tout, comme le dit Lorens Loewenhielm, « Ce soir, ma chère sœur, j’ai appris que, dans notre beau monde, tout est possible » ? Ici encore, plane sans doute l’ombre paternelle, et le désir irrépressible d’en effacer l’amertume, comme s’il était possible de consoler ce père post mortem.
Les personnages féminins
Malgré les personnages sympathiques que constituent Lorens Loewenhielm et Achille Papin, et l’emprise exercée sur tout le village par le pasteur, père des deux sœurs, l’importance des rôles féminins est très prononcée, et il ne serait pas tolérable de le passer sous silence.
Ce qui rejoint un autre contexte puisque les historiens ont noté l’importance exceptionnelle de la participation des femmes au mouvement communard, créant un des premiers mouvements féminins de masse, l’Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, réclamant le droit au travail et à l’égalité des salaires. On se souvient des personnalités féminines les plus éminentes que furent Louise Michel, institutrice et militante anarchiste morte en 1905 à Marseille, Élisabeth Dmitrieff, jeune aristocrate russe représentant la Première Internationale, morte probablement à Moscou entre 1910 et 1918, et Nathalie Lemel, ouvrière relieuse bretonne, déportée avec Louise Michel et décédée en 1921 à Ivry-sur-Seine. C’est cette importance de l’implication féminine (voire féministe) qui alimenta la propagande haineuse contre les prétendues « pétroleuses ».
À propos du thème d’un personnage féminin rescapé de la Commune de Paris, on peut rappeler deux films récents, qui n’ont peut-être pas rencontré le succès qu’ils méritaient :
· Louise Michel la rebelle, de Sólveig Anspach, avec Sylvie Testud dans le rôle principal, sorti en 2010. Le film décrit la période de déportation de Louise Michel en Nouvelle-Calédonie. Sylvie Testud est excellente dans le rôle principal.
· Louise Violet, un film d’Éric Besnard sorti en 2024 avec Alexandra Lamy dans le rôle principal, portrait d’une jeune institutrice créant la première école publique dans un village du Massif central et ayant à surmonter les préjugés et les intérêts immédiats des paysans hostiles à l’éducation, après avoir elle aussi fui la répression versaillaise. Le film a connu 700.000 entrées pour un budget de 5,7 millions d’euros.
Les trois actrices, Stéphane Audran (Babette), Sylvie Testud (Louise Michel) et Alexandra Lamy (Louise Violet) partagent un jeu retenu, discret, laissant beaucoup d’espace au spectateur qui a envie de comprendre ce qui se passe dans leur for intérieur. Ce sont trois personnages marqués par un vécu irrécupérable, une forme de deuil, et par la dimension collective d’une époque révolue, même si le personnage de Babette ne se réfugie d’abord dans une longue mise entre parenthèses que pour la faire rejaillir dans un potlatch nécessairement surdimensionné.
Sur un plan plus anecdotique…
La tenue très modeste et discrète portée par Stéphane Audran fut conçue par Karl Lagerfeld.
Rappelons qu’en 1968, Orson Welles avait tourné un film sur la base d’une brève nouvelle de Karen Blixen, L’éternelle histoire. Le film s’appelle The Immortal Story, les deux acteurs principaux sont Orson Welles et Jeanne Moreau. On pouvait le visionner sur YouTube, malgré une très mauvaise qualité de l’image, mais la vidéo semble désormais totalement enrayée (peut-être sera-t-elle rétablie) :
En voici une brève présentation :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Une_histoire_immortelle
Et enfin, une petite coïncidence, qui n’en est peut-être pas une.
Dans la série danoise Borgen, très populaire en France, le personnage principal, la première ministre Birgitte Nyborg, est interprété par l’actrice Sidse Babett Knudsen.
À propos de cette actrice née en 1968, on peut se demander si son second prénom, Babett, n’a pas été choisi en souvenir de la célèbre nouvelle de Blixen.
Mais l’analogie va plus loin.
Comme Karen Blixen, Sidse Babett Knudsen a longuement séjourné en Afrique, notamment en Tanzanie où elle a été élève dans une école internationale.
Et à 18 ans, à l’instar du père de Karen Blixen, elle est venue s’établir à Paris pour y passer six années consécutives (et apprendre le français).
Y aurait-il une sorte de tropisme français au royaume du Danemark ?…
JPB
Bibliographie :
· Georges Bataille, La part maudite, Éditions de Minuit, 1949
· Karen Blixen, Le festin de Babette et autres contes, Gallimard Folio 2007, traduction et Avant-Propos d’Alain Gnaedig
· Karen Blixen, Afrique, coll. Quarto, Gallimard 2006
· Alain Caillé, Extensions du domaine du don, Actes Sud, 2019
· Wilhelm Dinesen, Paris sous la Commune, traduction de Denise Bernard-Folliot, avant-propos de Jean-François Bataill, éditions Michel de Maule 2004
· Marcel Mauss, Essai sur le don, 1925, dans : Sociologie et anthropologie, PUF, 1966
[1] Avec sa logique constituée par trois obligations : l’obligation de donner (pour être reconnu et créer le lien), l’obligation de recevoir (pour ne pas vexer le donateur et pour ne pas briser le lien), et l’obligation de rendre (qui peut intervenir beaucoup plus tard, ouvrant ainsi une période de validité du lien social). Cet engrenage fonctionne quasiment comme un système de dette, tandis que l’achat marchand, qui gouverne les sociétés contemporaines, abroge tout délai par un paiement immédiat sans créer de lien social.
[2] « Les seules choses que nous aurons le droit d’emporter en quittant cette vie terrestre, ce seront celles que nous aurons données aux autres », dit un convive du festin de Babette (p. 69). C’est une reprise modifiée d’un verset biblique abondamment repris (1 Timothée 6 :7) « car nous n’avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n’en pouvons rien emporter ». Ce qui est donné fera partie de la personne, contrairement aux biens accumulés.
[3] Pour disposer d’une vue d’ensemble des contextes très diversifiés où se déploie le don, le livre d’Alain Caillé, Extensions du domaine du don, Actes Sud, 2019, est particulièrement recommandable. Pour une interprétation du don comme forme d’une dépense gratuite et irrépressible, tendant à la pure consumation, l’ouvrage de référence reste celui de Georges Bataille, La part maudite, Éditions de Minuit, 1949.
[4] Le théologien romain Tertullien (né et mort à Carthage en 160 – 220 après JC) écrivait dans son Apologétique : « Notre repas fait voir sa raison d’être par son nom : on l’appelle d’un nom qui signifie « amour » chez les Grecs (coena nostra de domine rationem sui ostendit. Id vocature quo dilectio penes Graecos). Quelles que soient les dépenses qu’il coûte, c’est profit que de faire des dépenses par une raison de piété : en effet, c’est un rafraîchissement (refrigerium) par lequel nous soulageons les pauvres, non que nous les traitions comme vos parasites, qui aspirent à la gloire d’asservir leur liberté, à condition qu’ils puissent se remplir le ventre au milieu des avanies, mais parce que, devant Dieu, les humbles jouissent d’une considération plus grande » (https://fr.wikipedia.org/wiki/Agapes). Dans la philosophie grecque, en effet, le terme agapé (ἀγάπη) désignait une forme d’amour inconditionnel tournée vers l’universel (amour de la vérité, amour de l’humain en général), par opposition à l’éros, amour physique, et à la philia, lien social d’amitié.
[5] N’ayant pas lu les autres écrits de Karen Blixen, nous ignorons si l’on peut en dire de même à leur propos. En revanche, le livre et le film éponyme Out of Africa, une histoire autobiographique de Karen Blixen, ne manquent pas de mettre en scène une confidence faite par le personnage de Blixen (joué par Meryl Streep) à son amant, Denys Finch Hatton (interprété par Robert Redford) : son père est parti aux Etats-Unis vivre dans la nature sauvage, et il s’est suicidé lorsqu’elle avait dix ans. Ce père n’est jamais bien loin.
[6] « Dans les derniers jours de juin 1871, Dinesen quitta Paris, « las de corps et d’âme », comme il le précise à la fin de son récit, et rentra au Danemark, à Katholm, dans la demeure familiale, où il parvint en juillet. Il s’y attela à la rédaction à la rédaction de Paris sous la Commune, qui l’occupa jusqu’en 1872, en s’appuyant notamment sur la documentation considérable qu’il avait ramenée de son dramatique séjour parisien – articles de journaux, extraits de discours tenus dans les clubs, proclamations officielles des deux camps… » (Note de la traductrice, Denise Bernard-Folliot).
[7] Expression énigmatique. Eugénie de Montijo, épouse de Napoléon III, devint régente en juillet 1870 et fut la principale adepte d’une guerre franco-prussienne, bien plus que son mari, largement manipulé par elle. En septembre de la même année, l’impératrice se réfugia en Angleterre. Au moment de la Commune, elle ne vivait plus en France. Les motifs de la fuite d’Eugénie et de Babette sont diamétralement opposés. La confusion faite par Papin met sur le même plan ces deux femmes totalement étrangères l’une à l’autre, au mépris de la confrontation politique du moment, et de façon incompatible avec la sympathie très vive que Papin manifeste pour la Commune.
[8] https://fr.wikipedia.org/wiki/Café_Anglais
[9] https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_de_Galliffet.
[10] Ces propos de B abette ont été largement estompés par Gabriel Axel mais il est bon de les prendre en compte pour bien comprendre la position subjective du personnage.
[11] Journaliste et dramaturge, fondateur avec Théodore de Banville, Henri Rochefort et Barbey d’Aurevilly (entre autres), du journal Le Nain jaune en 1863 ; opposé à la Commune et dénonciateur du communard Lavalette à la police.
[12] Pauline Clémentine Marie Walburge, comtesse Sándor von Szlavnicza, puis princesse de Metternich-Winneburg zu Bellstein (1836 – 1921), aristocrate austro-hongroise tenant un salon parisien pendant le Second Empire.
[13] Theodor W. Adorno, Mahler, Suhrkamp 1960, p. 82.
[14] Les autres habitants du village ne sont pas épargnés par cette problématique : « Il y avait parmi les fidèles deux vieilles femmes qui, avant leur conversion, s’étaient répandues en ragots malveillants qui avaient coûté à l’une un bon mariage, à l’autre un héritage. À leur âge avancé, elles ne se rappelaient plus clairement les événements de la veille, mais elles se souvenaient fort bien de ce qui s’était passé quarante ans plus tôt, elles ressassaient les comptes à régler, sans cesser de se regarder de travers. Il y avait aussi un vieux frère qui soudain, s’était mis à songer à la manière dont un frère aussi âgé que lui l’avait jadis dupé dans une affaire. Il aurait volontiers tiré un trait sur le passé, mais il n’y parvenait point, comme si cette pensée demeurait une écharde enfoncée dans son esprit. Il y avait encore un brave patron pêcheur aux cheveux gris et une veuve pieuse, toute ridée, qui, au printemps de leur jeunesse, avaient été amants alors qu’elle était l’épouse d’un autre homme. Ces derniers temps, ce souvenir s’était mis à les ronger, chacun rejetant la faute sur l’autre et s’inquiétait des conséquences que leurs actes auraient dans la vie éternelle. Ils évitaient le regard de l’autre chaque fois qu’ils se croisaient dans la maison jaune. » (ibidem, p. 50)


