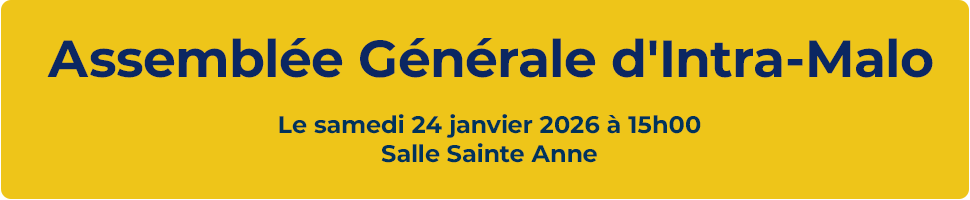À travers le portrait de monsieur Klein, un marchand d’art opportuniste dans la France occupée, Joseph Losey interroge la notion d’identité d’un homme, ainsi que la conscience et le regard de chacun. Film trouble et complexe, servi par d’inoubliables interprètes (signalons, aux côtés d’Alain Delon, Jeanne Moreau, Suzanne Flon, Michael Lonsdale, Louis Seigner et une très brève apparition de Gérard Jugnot alors au début de sa carrière), il fut hélas mal compris du public et, malgré l’oscar du meilleur film en 1977, son exploitation fut un échec commercial.
UN FILM ANGOISSANT ET TROUBLANT
Robert Klein, la quarantaine, est beau, riche, intelligent, plutôt cultivé. Mais ses activités professionnelles font de lui un homme dénué de tout scrupule qui profite de la détresse des autres pour réaliser des profits plutôt choquants dans cette période trouble de l’Occupation, bien présente dans le film de Joseph Losey. L’une des premières scènes montre la façon dédaigneuse dont il procède avec l’un de ses « clients », Juif aux abois obligé de s’exiler et de vendre – et donc de brader dans l’urgence – un tableau hollandais d’Adrien Van Ostade. Klein s’y révèle cynique, sans aucune compassion, uniquement attiré par l’acquisition d’une toile négociée au dessous de sa valeur. Le vendeur lui dit au cours de la transaction : « Faites-moi au moins une offre raisonnable ». Klein rétorque : « Je ne suis pas collectionneur… J’achète, je vends et je ne suis pas obligé d’acheter »…. Mais en raccompagnant son visiteur, Robert Klein découvre sur son paillasson un exemplaire d’Informations juives, le périodique édité par l’Union générale des Israélites de France. Adressé à son nom, le journal fait craindre au non-juif qu’est Robert Klein d’avoir été confondu avec un homonyme «israélite».
Pensant à une « mauvaise blague » ou à une erreur, il se rend au siège du journal puis au commissariat, attirant ainsi les soupçons sur lui. Dès lors, une machination diabolique s’enclenche où Robert Klein essaiera de prouver qu’il n’est pas juif et qu’il n’est pas celui qu’on croit. Au-delà des « brisures du moi », le spectateur est convié à une véritable quête d’identité, labyrinthique et mystérieuse qui ne trouvera d’issue que dans la rafle du Vel d’hiv.
UN SCENARIO CAUCHEMARDESQUE
Franco Salinas, auteur du scenario, a bien su tirer parti du contexte dramatique de l’Occupation, bien que Mr. Klein ne soit pas considéré comme un film historique. Au cours de ces années noires, des résistants se cachent et changent de nom, des Juifs quittent la France ou se procurent de faux papiers : les identités multiples fleurissent dans un climat délétère et dangereux, on s’abrite derrière un double fantomatique pour échapper aux arrestations de la Gestapo, on est soupçonné quotidiennement d’être ce que l’on n’est pas. Et le scenario du film exploite à merveille le parcours labyrinthique d’un homme cherchant à prouver qu’il n’est pas juif, qu’il est bien ce qu’il est, un marchand d’art du nom de Robert Klein et qui n’avait jusqu’alors pas eu à s’interroger sur lui-même, sur ses origines, sur sa famille, sur son entourage, sur les persécutions juives qui, a priori, ne le concernaient pas.
Derrière ces multiples péripéties, deux courants narratifs vont s’entremêler : la quête identitaire et le thème du double.
QUI SUIS-JE ?
Cette interrogation qui introduit le célèbre roman d’André Breton Nadja pourrait servir d’exergue au film de Joseph Losey. Troublé, inquiet, piégé dans sa vie plutôt confortable malgré les difficultés de l’époque, Robert Klein se mue en Sherlock Holmes pour élucider l’énigme qui se referme sur lui peu à peu tel un piège kafkaïen. Pourquoi cherche-t-on à prendre – ou à voler – son identité ? Qui cherche à se cacher derrière lui ? Est-ce un Juif ? C’est peu probable et trop dangereux : un Juif aurait pris l’identité d’un non-juif et non celle d’un homonyme. Est-ce, comme l’ont affirmé certains commentateurs, un résistant voulant échapper à la surveillance de la Gestapo et de la police de Vichy ? Option peu crédible également : porter un patronyme juif pendant l’Occupation attirait trop l’attention.
Dans cet imbroglio, Robert Klein cherche d’abord à prouver qu’il n’est pas juif. Il demande à son père de lui fournir des certificats de baptême, et ce dernier lui jure sur le ton de la colère que sa famille est française et catholique depuis Louis XIV. Toutefois, il admet qu’il y a quelques doutes possibles : les Klein de Hollande qui seraient peut-être d’origine juive.
De Strasbourg où habite son père au château mystérieux où se déroule un concert nocturne très étrange et où Delon pénètre dans un univers hors du temps (clin d’œil au domaine perdu du Grand Meaulnes d’Alain-Fournier ou au Château de Franz Kafka ?), des rues désertes et nocturnes de Paris à la brasserie de la Coupole envahie par la foule des clients, de la morgue aux cabarets louches, Robert Klein court après des fantômes à la recherche de son passé, de ses origines, en quête d’une vérité qu’il ne trouvera jamais. Et ses pérégrinations dans une ville labyrinthique et diabolique où on le prend sans cesse pour un autre aboutiront à la rafle du Vel d’hiv du 16 juillet 1942 où il sera arrêté sans vraiment comprendre ce qui lui arrive.
Dans cette spirale d’un « absurde cauchemardesque », qui a pour origine une démarche logique et cohérente (dissiper un malentendu auprès des autorités et retrouver la trace celui auquel était destiné le numéro d’Informations juives), Robert Klein verra son destin basculer vers l’horreur. Ironie du sort ou juste retour des choses ? On peut se le demander : le « bourreau raffiné » qu’était ce marchand d’art qui spoliait des Juifs au début du film va connaître le sort des victimes de la Shoah. Dans le convoi qui l’emmène vers les camps de la mort, il retrouve son « client » auquel il a acheté à vil prix le tableau d’Adrien Van Ostade. Les lointaines origines hollandaises d’une branche de sa famille (branche dont on cachait soigneusement l’existence car elle était probablement juive) refont ici surface. Dans cette scène finale, Robert Klein serait-il un Juif parmi les siens, malgré les certificats de baptême obtenus à grand peine et que lui tend en vain son ami avocat ?
UN DOUBLE INVISIBLE MAIS OMNIPRESENT
Robert Klein s’enferme dès le début de l’histoire dans une quête obsessionnelle pour débusquer « l’autre », son double invisible qui ne le quitte pas d’une semelle. Dans cet itinéraire éprouvant et énigmatique, il accumule les interrogations, les fausses pistes, sentant peu à peu qu’un piège se referme sur lui. On peut trouver ici une similitude avec la célèbre nouvelle de Maupassant Le Horla, où le héros, en proie à des hallucinations quotidiennes et à une présence invisible qui altèrent sa santé mentale, essaie de comprendre ce qu’il lui arrive et de traquer cet être fantomatique au point de mettre volontairement le feu à sa maison. Il cherche une explication rationnelle à une mécanique absurde et incompréhensible, tout comme Robert Klein cherche à rencontrer son alter ego pour savoir qui il est et connaître les raisons de sa « présence cachée ». Delon confie à son ami avocat : « Il faut que je sache, d’une façon ou d’une autre, ce que ce monsieur veut de moi. »
Le thème du double est ingénieusement souligné dans le film par les jeux de miroir (les glaces sont omniprésentes dans le film) où Robert Klein est à plusieurs reprises confronté à sa propre image, comme s’il avait un frère jumeau. La concierge de l’immeuble de la rue des Abbesses où habite « l’autre Klein, le faux ? » confond d’ailleurs les deux hommes et dit à Delon (le vrai monsieur Klein ?) : « Vous êtes bien monsieur Klein, le locataire du premier (…). Il a la même taille que vous, les mêmes cheveux, la même allure. » Dans une autre scène, le groom de la brasserie La Coupole qui cherche un monsieur Klein (mais lequel ?), sonnette et ardoise à la main, semble confondre lui aussi les deux personnages.
En fait, Joseph Losey et Franco Salinas brouillent les pistes à plaisir : dans un cadre rationnel et bien ancré historiquement, ils instillent peu à peu une dose d’irrationalité qui confine au fantastique et confronte le spectateur à un univers incompréhensible et absurde digne des romans de Kafka. On partage dès le début du film les doutes, les interrogations, les angoisses de Robert Klein car, comme lui, on ne comprend pas les raisons du piège dans lequel il se trouve emprisonné.
Finalement, il cherche à fuir, à partir pour l’étranger sous une fausse identité avec de faux papiers que lui procure l’un de ses amis avocat, puis change brutalement d’avis dans le train qui le mène hors de France. Rentré à Paris, il téléphone au mystérieux monsieur Klein qui souhaite, lui aussi, le rencontrer : le spectateur n’entendra que sa voix, que ces quelques mots : « Moi aussi, je voulais vous rencontrer….) Au moment où les deux Robert Klein doivent se voir physiquement, le second monsieur Klein, le double invisible est arrêté par la police à la porte de son domicile, rue des Abbesses. On ne connaîtra donc pas la solution de l’énigme.
Et si Delon, le vrai monsieur Klein, avait rêvé tout ça… Et si toute cette histoire cauchemardesque et incompréhensible n’avait existé que dans sa tête ? Une fois encore, on pense au héros du Horla, hanté par une présence invisible qu’il ne verra jamais. A la fin de la nouvelle de Maupassant, ce personnage anonyme songe volontairement à se suicider pour mettre un terme à son calvaire, à son dédoublement de personnalité. A la fin du film, Robert Klein est déporté malgré lui vers les camps de la mort.
En conclusion, Monsieur Klein apparaît comme une dystopie où le personnage incarné par Alain Delon est incapable d’échapper à ses démons intérieurs (on pense à la schizophrénie) dans un contexte historique où les dirigeants (la police française, les nazis) exercent une autorité totale sur les citoyens. Le libre arbitre de Robert Klein est donc pris en étau entre un piège diabolique et angoissant, peut-être imaginaire, qui mine sa santé mentale (ne dit-il pas à son ami avocat « Je suis fou » ?) et une réalité elle aussi angoissante, mais bien réelle, liée au contexte des années noires de l’Occupation. Finalement, le cauchemar personnel et intime vécu par Alain Delon tout au long du film trouve son aboutissement dans un autre cauchemar, collectif celui-là : la rafle du Vel d’hiv.
PLR