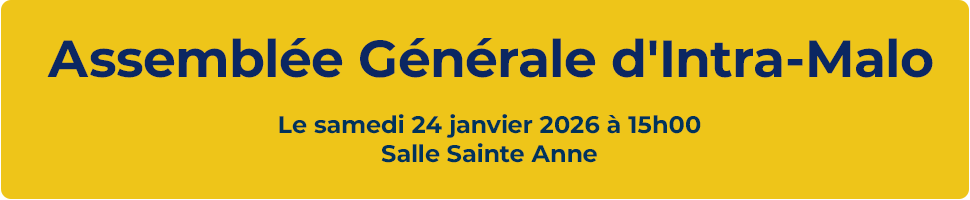Traduit de l’italien par MYRIEM BOUZAHER
Le texte italien original a paru sous le titre « Postille al Nome della Rosa » dans Alfabeta 49, juin 1983.
Rosa que al prado, encarnada, te ostentas presuntüosa de grana y carmín bañada : campa lozana y gustosa ; pero no, que siendo hermosa también serás desdichada.
Juana Inés de la Cruz
Le titre et le sens.
Depuis que j’ai écrit le Nom de la rose, je reçois de nombreuses lettres de lecteurs, la plupart pour me demander ce que signifie l’hexamètre latin final et comment il a engendré le titre. Invariablement, je réponds qu’il s’agit d’un vers tiré du De contemptu mundi de Bernard de Morlaix, un bénédictin du XIIe siècle, qui s’est livré à des variations sur le thème de l’ubi sunt (d’où a dérivé par la suite le mais où sont les neiges d’antan de Villon) et a rajouté au topo courant (les grands de jadis, les villes célèbres, les belles princesses, le néant où tout finit par s’évanouir) l’idée que, bien que toutes les choses disparaissent, nous conservons d’elles de purs noms. Je rappelle aussi qu’Abélard utilisait l’exemple de l’énoncé nulla rosa est pour montrer à quel point le langage pouvait tout autant parler des choses abolies que des choses inexistantes. Après quoi, je laisse le lecteur tirer ses conclusions, considérant qu’un narrateur n’a pas à fournir d’interprétations à son oeuvre, sinon ce ne serait pas la peine d’écrire des romans, étant donné qu’ils sont, par excellence, des machines à générer de l’interprétation. Seulement voilà, tous ces beaux propos pleins de virtuosité achoppent sur un obstacle incontournable : un roman doit avoir un titre.
Or, un titre est déjà — malheureusement — une clé interprétative. On ne peut échapper aux suggestions générées par le Rouge et le Noir ou par Guerre et Paix. Les titres les plus respectueux du lecteur sont ceux qui se réduisent au seul nom du héros éponyme, comme David Copperfield ou Robinson Crusoé ; et encore, la référence à l’éponyme peut constituer une ingérence abusive de la part de l’auteur. Le Père Goriot attire l’attention sur la figure du vieux père, alors que le roman est aussi l’épopée de Rastignac ou de Vautrin alias Collin. Peut-être faudrait-il être honnêtement malhonnête comme Dumas, dont les Trois Mousquetaires sont l’histoire d’un quatuor. Mais ce sont là des luxes rares que l’auteur ne peut se permettre que par erreur.
En fait, mon roman avait un autre titre de travail, l’Abbaye du crime. Je l’ai écarté parce qu’il insiste sur la seule trame policière et ainsi pouvait indûment amener d’infortunés acquéreurs, friands d’histoire et d’action, à se précipiter sur un livre qui les aurait déçus. Mon rêve était d’intituler le livre Adso de Melk. Titre très neutre, car après tout Adso était la voix du récit. Mais en Italie, les éditeurs n’aiment pas les noms propres : même Fermo e Lucia{229} a été recyclé, et pour le reste, il y a bien peu d’exemples — Lemmonio Boreo, Rubè ou Metello… Autant dire rien, par rapport aux légions de Cousine Bette, de Barry Lindon, d’Armance et de Tom Jones qui peuplent d’autres littératures.
L’idée du Nom de la rose me vint quasiment par hasard et elle me plut parce que la rose est une figure symbolique si chargée de significations qu’elle finit par n’en avoir plus aucune, ou presque : la rose mystique, et rose elle a vécu ce que vivent les roses, la guerre des deux roses, une rose est une rose est une rose est une rose, les rose-croix, merci de ces magnifiques roses, la vie en rose. Le lecteur était désorienté, il ne pouvait choisir une interprétation ; et même s’il saisissait les possibles lectures nominalistes du vers final, quand justement il arrivait à lui, il avait déjà fait dieu sait quels autres choix. Un titre doit embrouiller les idées, non les embrigader.
Rien ne console plus l’auteur d’un roman que de découvrir les lectures auxquelles il n’avait pas pensé et que les lecteurs lui suggèrent. Quand j’écrivais des ouvrages théoriques, mon attitude envers les critiques était de nature « judiciaire » : ont-ils compris ou non ce que je voulais dire ? Avec un roman, c’est complètement différent. Je ne dis pas que l’auteur ne puisse découvrir une lecture qui lui semble aberrante, mais dans tous les cas il devrait se taire : aux autres de la contester, texte en main. Pour le reste, la grande majorité des lectures fait découvrir des effets de sens auxquels on n’avait pas pensé. Mais que signifie le fait de ne pas y avoir pensé ?
Une universitaire française, Mireille Calle Gruber, a déniché de subtils paragrammes qui unissent les simples (au sens de pauvres) aux simples au sens d’herbes médicinales, puis elle découvre que je parle de « male plante » de l’hérésie. Je pourrais répondre que le terme « simples » est récurrent dans les deux cas dans la littérature de l’époque, ainsi que l’expression « male plante ». D’autre part, je connaissais bien l’exemple de Greimas sur la double isotopie qui naît lorsqu’on définit l’herboriste comme « ami des simples ». Avais-je ou non conscience de jouer de paragrammes ? Rien ne sert de le dire maintenant, le texte est là et il produit ses propres effets de sens.
En lisant les critiques du roman, je frissonnais de bonheur quand j’en trouvais une (les premières ont été celles de Ginevra Bompiani et de Lars Gustaffson) qui citait une réplique prononcée par Guillaume à la fin du procès d’inquisition (page 391 de l’édition française). « Qu’est-ce qui vous effraie le plus dans la pureté ? » demande Adso. « La hâte », répond Guillaume. J’aimais beaucoup, et j’aime encore, ces deux lignes.
Et puis un lecteur m’a fait remarquer qu’à la page suivante Bernard Gui, menaçant le cellérier de torture, dit : « La justice n’agit pas avec précipitation, comme croyaient les pseudo-apôtres, et celle de Dieu a des siècles à sa disposition. » La traduction française emploie deux mots différents mais en italien on répétait deux fois le mot « fretta » (hâte). Et le lecteur, à juste titre, me demandait quel rapport j’avais voulu instaurer entre la hâte redoutée par Guillaume et l’absence de hâte célébrée par Bernard. Je me suis alors rendu compte qu’il s’était produit quelque chose d’inquiétant. L’échange de répliques entre Adso et Guillaume n’existait pas dans le manuscrit. Ce bref dialogue, je l’ai ajouté sur les épreuves : pour des raisons d’élégance de style, j’avais besoin d’insérer encore un temps fort avant de redonner la parole à Bernard. Et bien entendu, alors que je faisais haïr la hâte à Guillaume (avec beaucoup de conviction d’ailleurs, ce qui me fit aimer cette réplique), j’avais complètement oublié qu’un peu plus loin Bernard parlait de précipitation. Si on relit la réplique de Bernard sans celle de Guillaume, ce n’est rien d’autre qu’une façon de parler, c’est l’affirmation que l’on attendrait de la bouche d’un juge, c’est une phrase toute faite comme : « La justice est égale pour tous. » Seulement voilà, opposée à la hâte nommée par Guillaume, la hâte nommée par Bernard fait légitimement naître un effet de sens, et le lecteur a raison de se demander s’ils parlent de la même chose, ou si la haine de la hâte exprimée par Guillaume n’est pas insensiblement différente de la haine de la hâte exprimée par Bernard. Le texte est là et il produit ses propres effets. Que je le veuille ou non, on se trouve maintenant face à une question, à une provocation ambiguë ; quant à moi je suis bien embarrassé pour interpréter cette opposition, tout en comprenant qu’un sens (plus peut-être) est venu se nicher ici.
L’auteur devrait mourir après avoir écrit. Pour ne pas gêner le cheminement du texte.
Raconter le processus
Certes, l’auteur ne doit pas interpréter. Mais il peut raconter pourquoi et comment il a écrit. Les essais de poétique ne servent pas toujours à comprendre l’oeuvre qui les a inspirés, mais ils servent à comprendre comment on résout ce problème technique qu’est la production d’une oeuvre.
Poe dans sa Genèse d’un poème raconte comment il a écrit le Corbeau. Il ne nous dit pas comment nous devons le lire, mais quels problèmes il s’est posés pour réaliser un effet poétique. Et je définirais l’effet poétique comme la capacité, exhibée par un texte, de générer des lectures toujours différentes, sans que jamais on en épuise les possibilités.
L’écrivain (ou le peintre ou le sculpteur ou le compositeur) sait toujours ce qu’il fait et ce que cela lui coûte. Il sait qu’il doit résoudre un problème. Les données de départ sont peut-être obscures, pulsionnelles, obsédantes, ce n’est souvent rien de plus qu’une envie ou un souvenir. Mais ensuite le problème se résout sur le papier, en interrogeant la matière sur laquelle on travaille — matière qui exhibe ses propres lois naturelles mais qui en même temps amène avec elle le souvenir de la culture dont elle est chargée (l’écho de l’intertextualité).
Quand l’auteur nous dit qu’il a travaillé sous le coup de l’inspiration, il ment. Genius is twenty per cent inspiration and eighty per cent perspiration.
Lamartine écrivit à propos d’un de ses célèbres poèmes dont j’ai oublié le titre qu’il était né en lui d’un seul jet, par une nuit de tempête, dans un bois. A sa mort, on retrouva les manuscrits avec les corrections et les variantes : c’était le poème peut-être le plus « travaillé » de toute la littérature française !
Quand l’écrivain (ou l’artiste en général) dit qu’il a travaillé sans penser aux règles du processus il veut seulement dire qu’il travaillait sans savoir qu’il connaissait la règle. Un enfant parle très bien sa langue maternelle et pourtant il ne saurait en écrire la grammaire. Mais le grammairien n’est pas le seul à connaître les règles de la langue parce que l’enfant, sans le savoir, les connaît très bien lui aussi : le grammairien est celui qui sait pourquoi et comment l’enfant connaît la langue.
Raconter comment on a écrit ne signifie pas prouver que l’on a « bien » écrit. Poe disait que « l’effet de l’oeuvre est une chose et la connaissance du processus en est une autre ». Quand Kandinsky ou Klee nous racontent comment ils peignent, ils ne nous disent pas si l’un des deux est meilleur que l’autre. Quand Michel-Ange nous dit que sculpter signifie libérer de son oppression la figure déjà inscrite dans la pierre, il ne nous dit pas si la Pietà du Vatican est plus belle que la Pietà Rondanini. Il arrive que les pages les plus lumineuses sur les processus artistiques aient été écrites par des artistes mineurs qui réalisaient des effets modestes mais savaient bien réfléchir sur leurs propres processus : Vasari, Horatio Greenough, Aaron Copland…
Le Moyen Age, bien sûr
J’ai écrit un roman parce que l’envie m’en est venue. Je pense que c’est une raison suffisante pour se mettre à raconter. L’homme est un animal fabulateur par nature. J’ai commencé à écrire en mars 1978, mû par une idée séminale. J’avais envie d’empoisonner un moine.
Je crois qu’un roman peut naître d’une idée de ce genre, le reste est chair que l’on ajoute, chemin faisant. Cette idée devait être plus ancienne. J’ai retrouvé un cahier daté de 1975 où j’avais inscrit une liste de moines vivant dans un vague couvent. Rien d’autre. Au début, je me suis mis à lire le Traité des poisons d’Orfila — que j’avais acheté il y a vingt ans chez un bouquiniste de Paris, pour de simples raisons de fidélité à Huysmans (Là-bas,).
Comme aucun des poisons ne me satisfaisait, j’ai demandé à un ami biologiste de m’indiquer un remède qui ait des propriétés déterminées (être absorbé par voie cutanée, en manipulant quelque chose). J’ai aussitôt détruit la lettre où celui-ci me répondait qu’il ne connaissait pas de poison correspondant à ce que je cherchais ; ce sont là des documents qui, lus dans un autre contexte, pourraient vous conduire tout droit en prison.
Au début, mes moines devaient vivre dans un couvent contemporain (je pensais à un moine investigateur qui lisait le « Manifesto »). Mais comme un couvent, ou une abbaye, vivent encore de nombreux souvenirs médiévaux, je me suis mis à feuilleter mes archives de médiéviste en hibernation (un livre sur l’esthétique médiévale en 1956, cent autres pages sur le même sujet en 1959, quelques essais en passant, des retours à la tradition médiévale en 1962 pour mon travail sur Joyce, puis en 1972 la longue étude sur l’Apocalypse et sur les miniatures du commentaire de Beatus de Liebana : donc, le Moyen Age était toujours en activité). Je suis tombé sur un vaste matériel (fiches, photocopies, cahiers) qui s’accumulait depuis 1952, destiné à d’autres buts très imprécis : pour une histoire des monstres ou une analyse des encyclopédies médiévales ou une théorie du catalogue… A un moment donné, je me suis dit que puisque le Moyen Age était mon imaginaire quotidien, autant valait écrire un roman qui se déroule directement à cette époque. Comme je l’ai dit dans certaines interviews, je ne connais le présent qu’à travers mon écran de télévision tandis que j’ai une connaissance directe du Moyen Age. Quand, à la campagne, nous allumions des feux dans les prés, ma femme m’accusait de ne pas savoir regarder les étincelles qui s’élevaient au milieu des arbres et voletaient le long des fils de lumière. Lorsque, ensuite, elle a lu le chapitre sur l’incendie, elle m’a dit : « Mais alors, les étincelles, tu les regardais ! » J’ai répondu : « Non, mais je savais comment un moine du Moyen Age les aurait vues. »
Il y a dix ans, en joignant une lettre de l’auteur à l’éditeur à mon commentaire du commentaire de l’Apocalypse de Beatus de Liebana (pour Franco Maria Ricci), je confessais : « Quoi que l’on fasse, je suis né à la recherche en traversant des forêts symboliques peuplées de licornes et de griffons, en comparant les structures pinaculaires et carrées des cathédrales aux pointes de malice exégétique celées dans les formules tétragones des Summulae, en vagabondant de rue du Fouarre aux nefs cisterciennes, en m’entretenant aimablement avec des moines clunisiens, érudits et fastueux, tenu à l’oeil par un Thomas d’Aquin grassouillet et rationaliste, tenté par Honorius d’Autun, par ses géographies fantastiques où l’on expliquait à la fois quare in pueritia coitus non contingat, comment on arrive à l’Ile Perdue et comment on capture un basilic muni d’un seul miroir de poche et d’une inébranlable foi dans le Bestiaire. »
Ce goût et cette passion ne m’ont jamais abandonné, même si par la suite, pour des raisons morales et matérielles (être médiéviste implique souvent une fortune considérable et la faculté de voyager de bibliothèques en bibliothèques lointaines pour faire les microfilms de manuscrits introuvables), j’ai emprunté d’autres chemins. Le Moyen Age est resté, sinon mon métier, du moins mon hobby — et ma tentation permanente, je le vois partout, en transparence, dans les choses dont je m’occupe qui semblent ne pas être médiévales et qui pourtant le sont.
« Des vacances secrètes sous les nefs d’Autun où, aujourd’hui l’abbé Grivot écrit, sur le Diable, des traités à la reliure imprégnée de soufre, des extases champêtres à Moissac et à Conques, aveuglé par les Vieillards de l’Apocalypse ou par des diables qui amoncellent les âmes damnées dans des chaudrons bouillonnants ; et parallèlement, les lectures régénératrices de Bède, le moine illuministe, les réconforts rationnels recherchés chez Occam, afin de mieux comprendre les mystères du Signe là où Saussure reste encore obscur. Et ainsi de suite, avec la continuelle nostalgie de la Peregrinatio Sancti Brandani, les contrôles de notre pensée dans le livre de Kells, Borges revisité dans les kenningars celtes, les rapports entre pouvoir et masses convaincues, soumis à vérification dans les journaux de l’évêque Suger… »
Le masque
A la vérité, je n’ai pas seulement décidé de parler du Moyen Age. J’ai décidé de parler dans le Moyen Age, et par la bouche d’un chroniqueur de l’époque. J’étais un narrateur débutant, et les narrateurs, je les avais regardés jusqu’alors de l’autre côté de la barrière. J’avais honte de raconter. Je me sentais un peu comme ce critique de théâtre qui s’exposerait tout à coup aux feux de la rampe et se verrait regardé par ceux qui jusqu’à présent avaient été ses complices au parterre.
Peut-on dire : « C’était une belle matinée de la fin novembre » sans se sentir Snoopy ? Et si je le faisais dire à Snoopy ? C’est-à-dire si « c’était une belle matinée… », c’était quelqu’un d’autorisé à le dire qui le disait, parce que cela pouvait se faire à son époque ?
Un masque, voilà ce qu’il me fallait.
Je me suis mis à lire et à relire les chroniqueurs médiévaux, pour en acquérir le rythme et la candeur. Ils parleraient pour moi; et moi je serais libre de tout soupçon. Libre de tout soupçon, mais pas des échos de l’intertextualité. J’ai redécouvert ainsi ce que les écrivains ont toujours su (et que tant de fois ils nous ont dit) : les livres parlent toujours d’autres livres, et chaque histoire raconte une histoire déjà racontée. Homère le savait, l’Arioste le savait, sans parler de Rabelais ou de Cervantès. C’est pourquoi mon histoire ne pouvait que commencer par le manuscrit retrouvé, c’est pourquoi cette histoire aussi serait une citation (naturellement). J’écrivis tout de suite l’introduction, plaçant ma narration à un quatrième niveau d’emboîtement, à l’intérieur de trois autres narrations : moi je dis que Vallet disait que Mabillon a dit que Adso dit…
J’étais désormais libéré de toute crainte. J’ai alors cessé d’écrire pendant un an. J’ai arrêté parce que j’ai découvert une autre chose que je savais déjà (que tout le monde savait) mais que j’ai mieux comprise en travaillant.
J’ai découvert qu’un roman n’a rien à voir, en première instance, avec les mots. Ecrire un roman, c’est affaire de cosmologie, comme l’histoire que raconte la Genèse (il faut bien se choisir des modèles, disait Woody Allen).
Le roman comme fait cosmologique
Je pense que pour raconter, il faut avant tout se construire un monde, le plus meublé possible, jusque dans les plus petits détails. Si je construisais un fleuve, deux rives et si sur la rive gauche je mettais un pêcheur, si j’attribuais à ce pêcheur un caractère irascible et un casier judiciaire pas très net, voilà, je pourrais commencer à écrire, en traduisant en mots ce qui ne peut pas ne pas arriver. Que fait un pêcheur ? Il pêche (et voilà toute une séquence de gestes plus ou moins inévitables). Et puis, que se passe-t-il ? Soit ça mord, soit ça ne mord pas. Si ça mord, le pêcheur prend des poissons et s’en retourne chez lui tout content. Fin de l’histoire. Si ça ne mord pas, étant donné qu’il est irascible, peut-être va-t-il se mettre en colère. Peut-être cassera-t-il sa canne à pêche. Ce n’est pas grand-chose, mais c’est déjà une ébauche. Or, il y a un proverbe indien qui dit : « Assieds-toi sur la rive du fleuve et attends, le cadavre de ton ennemi ne tardera pas à passer. » Et si, entraîné par le courant, passait un cadavre, puisque la possibilité en est contenue dans l’aire intertextuelle du fleuve ? N’oublions pas que mon pêcheur a un casier judiciaire chargé. Voudra-t-il courir le risque de se mettre dans de sales draps ? Que fera-t-il ? Fuira-t-il, feindra-t-il de ne pas voir le cadavre ? Sentira-t-il peser sur lui tous les soupçons, car, après tout, ce cadavre est celui de l’homme qu’il haïssait ? Irascible comme il l’est, s’emportera-t-il parce qu’il n’a pu accomplir lui-même la vengeance ardemment désirée ? Vous voyez, il a suffi de meubler le monde avec presque rien, et déjà il y a début d’une histoire. Il y a aussi le début d’un style, parce qu’un pêcheur qui pêche devrait m’imposer un rythme narratif lent, fluvial, celui de son attente patiente mais aussi des sursauts de son impatiente irritabilité.
Il faut construire le monde, les mots viennent ensuite, presque tout seuls. Rem tene, verba sequentur. Le contraire de ce qui, je crois, se passe avec la poésie : verba tene, res sequentur.
La première année de travail sur mon roman a été consacrée à la construction du monde : longs régestes de tous les livres que l’on pouvait trouver dans une bibliothèque médiévale ; listes de noms et fiches d’état civil pour de nombreux personnages, dont beaucoup ont été ensuite éliminés de l’histoire (car il me fallait savoir aussi qui étaient les autres moines qui n’apparaissaient pas dans le livre ; il n’était pas nécessaire que le lecteur les connaisse, mais moi je me devais de les connaître). Qui a dit que la narrativité doit faire concurrence à l’état civil ? Peut-être doit- elle aussi faire concurrence au ministère de l’Urbanisme. D’où de longues enquêtes architecturales, sur des photos et des plans dans l’encyclopédie de l’architecture, pour établir le plan de mon abbaye, les distances, jusqu’au nombre de marches d’un escalier en colimaçon. Marco Ferreri m’a dit que mes dialogues sont cinématographiques parce qu’ils sont temporellement justes. Forcément. Quand deux de mes personnages parlaient en allant du réfectoire au cloître, j’écrivais, le plan sous les yeux, et quand ils étaient arrivés, ils cessaient de parler.
Il faut se créer des contraintes pour pouvoir inventer en toute liberté. En poésie, la contrainte peut être donnée par le pied, le vers, la rime, par ce que les contemporains ont appelé le souffle selon l’oreille… Pour la narrativité, la contrainte est donnée par le monde sous-jacent. Et cela n’a rien à voir avec le réalisme (même si cela explique jusqu’au réalisme). On peut construire un monde totalement irréel, où les ânes volent et où les princesses sont ressuscitées par un baiser : mais il faut que ce monde, purement possible et irréaliste, existe selon des structures définies au départ (il faut savoir si c’est un monde où une princesse peut être ressuscitée uniquement par le baiser d’un prince, ou encore par celui d’une sorcière, si le baiser d’une princesse retransforme en princes les seuls crapauds ou bien aussi, mettons, les tatous).
L’Histoire aussi faisait partie de mon monde, voilà pourquoi j’ai lu et relu tant de chroniques médiévales ; en les lisant, je me suis aperçu que devaient entrer dans mon roman des choses qui au début ne m’avaient même pas effleuré, comme les luttes pour la pauvreté ou l’inquisition contre les fraticelles.
Un exemple : pourquoi dans mon livre y a-t-il des fraticelles du XIVe siècle ? Quitte à écrire une histoire médiévale, autant la situer au XIIIe ou au XIIe siècle, car je les connaissais mieux que le XIVe. Oui, mais j’avais besoin d’un investigateur, anglais si possible (citation intertextuelle), qui ait un grand sens de l’observation et une particulière sensibilité à l’interprétation des indices. Ces qualités, on ne les trouvait que dans le milieu franciscain, et après Roger Bacon ; en outre, on n’a une théorie développée des signes que chez les occamistes ; plus exactement, cette théorie existait avant, mais avant, soit l’interprétation des signes était de type symbolique, soit elle tendait à lire dans les signes les idées et les universaux. C’est seulement chez Bacon ou Occam qu’on utilise les signes pour aller vers la connaissance des individus. Donc, je devais situer mon histoire au XIVe siècle, avec beaucoup d’irritation d’ailleurs, car je m’y sentais moins à l’aise. Je fis de nouvelles lectures et découvris qu’un franciscain du XIVe, même anglais, ne pouvait ignorer le débat sur la pauvreté, surtout s’il était ami, disciple ou connaisseur d’Occam. (Au début, j’avais décidé que l’investigateur devait être Occam lui-même, mais j’y ai renoncé parce que, humainement, le Vénérable Inceptor m’est antipathique !)
Mais pourquoi tout se passe-t-il à la fin du mois de novembre 1327 ? Parce qu’en décembre Michel de Césène est déjà en Avignon (voilà ce que signifie meubler un monde dans un roman historique : certains éléments, comme le nombre des marches, dépendent d’une décision de l’auteur, d’autres, comme les déplacements de Michel, dépendent du monde réel qui, dans ce type de roman, vient parfois coïncider avec le monde possible de la narration).
Or, novembre, c’était trop tôt. En effet, j’avais aussi besoin de tuer un cochon. Pourquoi ? Mais c’est tout simple, pour pouvoir fourrer, la tête la première, un cadavre dans une jarre de sang. Et pourquoi ce besoin ?
Parce que la seconde trompette de l’Apocalypse dit que… Je n’allais tout de même pas changer l’Apocalypse, elle faisait partie du monde. Il ne me restait qu’à situer l’abbaye en montagne, de façon à avoir déjà de la neige. Autrement, mon histoire aurait pu se dérouler en plaine, à Pomposa ou à Conques.
C’est le monde construit qui nous dit comment l’histoire doit avancer. Tout le monde me demande pourquoi mon Jorge évoque, par son nom, Borges et pourquoi Borges est si malfaisant. Mais je ne sais pas ! Je voulais un aveugle gardien d’une bibliothèque (ce qui me semblait être une bonne idée narrative) et bibliothèque plus aveugle ne peut donner que Borges, parce qu’aussi il faut bien payer ses dettes. Quand j’ai mis Jorge dans la bibliothèque, je ne savais pas encore que c’était lui l’assassin. Il a pour ainsi dire tout fait tout seul. Et qu’on n’aille pas penser qu’il s’agit là d’une position « idéaliste » — les personnages ont une vie propre et l’auteur, presque en transes, les fait agir en fonction de ce qu’ils lui suggèrent : ce sont des sottises, tout juste bonnes pour un sujet de dissertation au baccalauréat. Non. La vérité est que les personnages sont contraints d’agir selon les lois du monde où ils vivent et que le narrateur est prisonnier de ses prémisses.
Le labyrinthe fut aussi pour moi une belle aventure. Tous les labyrinthes dont j’avais eu connaissance, et j’avais entre les mains la splendide étude de Santarcangeli, étaient des labyrinthes à ciel ouvert. Ils pouvaient être très compliqués et pleins de circonvolutions. Mais moi, j’avais besoin d’un labyrinthe fermé (a-t-on jamais vu une bibliothèque à ciel ouvert ?) et s’il était trop compliqué, avec beaucoup de couloirs et de salles internes, il n’y avait plus une aération suffisante. Et une bonne aération était nécessaire pour alimenter l’incendie (que l’Edifice dût brûler à la fin, cela était très clair pour moi, pour des raisons cosmologico- historiques : au Moyen Age, les cathédrales et les couvents brûlaient tels des fétus de paille ; imaginer une histoire médiévale sans incendie, c’est comme imaginer un film de guerre dans le Pacifique sans un avion de chasse en flammes qui tombe en piqué). C’est pourquoi j’ai travaillé deux ou trois mois à la construction d’un labyrinthe adapté, et à la fin j’ai dû y ajouter des meurtrières, sinon l’air aurait toujours été insuffisant.
Qui parle
J’avais de nombreux problèmes. Je voulais un lieu clos, un univers concentrationnaire, et pour le mieux fermer, il fallait que j’introduise, outre les unités de lieu, les unités de temps (étant donné que l’unité d’action était incertaine). Donc, ce serait une abbaye bénédictine à la vie scandée par les heures canoniales (peut-être mon modèle inconscient était-il l’Ulysses à cause de la structure très stricte en heures du jour ; mais aussi la Montagne magique, pour le lieu rocheux et sanatorial où tant de conversations allaient devoir se passer).
Les conversations me posaient de gros problèmes que j’ai résolus en écrivant. Il est une thématique, peu traitée par les théories de la narrativité, qui est celle des turn ancillaries, c’est-à-dire les artifices grâce auxquels le narrateur passe la parole aux différents personnages. Voyons quelles différences il y a entre ces cinq dialogues :
1. — Comment vas-tu ?
— Pas mal, et toi ?
2. — Comment vas-tu ? dit Jean.
— Pas mal, et toi ? dit Pierre.
3. — Comment, dit Jean, comment vas-tu ?
Et Pierre, aussitôt : — Pas mal, et toi ?
4. — Comment vas-tu ? s’empressa Jean.
— Pas mal, et toi ? ricana Pierre.
5. — Jean dit : — Comment vas-tu ?
— Pas mal, répondit Pierre d’une voix incolore. Puis, avec un sourire indéfinissable : — Et toi ?
A l’exception des deux premiers cas, on observe dans les autres ce que l’on définit comme « instance de l’énonciation ». L’auteur intervient par un commentaire personnel pour suggérer le sens que peuvent prendre les paroles des deux personnages. Mais une telle intention est- elle vraiment absente des solutions apparemment arides des deux premiers cas ? Et le lecteur ? Est-il plus libre dans les deux cas aseptisés, ne pourrait-il y subir, à son insu, une charge émotive (que l’on pense à l’apparente neutralité du dialogue chez Hemingway !) ou bien est-il plus libre dans les autres cas où, au moins, il sait à quel jeu joue l’auteur ?
C’est un problème de style, un problème idéologique, un problème de « poésie », autant que le choix d’une rime, d’une assonance ou l’introduction d’un paragramme. Il s’agit de trouver une certaine cohérence. Peut-être étais-je aidé par le fait que tous les dialogues sont rapportés par Adso et que, bien évidemment, Adso impose son point de vue à toute la narration.
Les dialogues me posaient aussi un autre problème. Jusqu’à quel point pouvaient-ils être médiévaux ? En d’autres termes, je me rendais compte, à l’écriture, que le livre prenait une structure de mélodrame bouffe, avec de longs récitatifs et d’amples arias. Les arias (la description du portail, par exemple) se référaient à la grande rhétorique de l’Age Moyen, et là les modèles ne manquaient pas. Mais les dialogues ? A un moment donné, j’ai craint que les dialogues ne soient de l’Agatha Christie quand les Arias étaient du Suger ou du saint Bernard. Je suis allé relire les romans médiévaux, j’entends par là l’épopée chevaleresque, et je me suis aperçu que, malgré quelque licence de mon fait, je respectais un usage narratif et poétique qui n’était pas inconnu au Moyen Age. Mais la question m’a longtemps harcelé, et je ne suis pas sûr d’avoir résolu ces changements de registre entre aria et récitatif.
Un autre problème : l’emboîtement des voix ou instances narratives. Je savais que j’étais en train de raconter (moi) une histoire avec les mots d’un autre, après avoir averti dans la préface que les mots de cet autre avaient été filtrés par au moins deux autres instances narratives, celle de Mabillon et celle de l’abbé Vallet ; et l’on pouvait bien sûr supposer que ceux-ci avaient oeuvré en philologues sur un texte non manipulé (mais qui va croire ça ?). Pourtant, le problème se reposait à l’intérieur même de la narration faite à la première personne par Adso. Celui-ci raconte à quatre-vingts ans ce qu’il a vécu à dix-huit ans. Qui parle, l’Adso de dix- huit ans ou l’Adso octogénaire ? Tous les deux, c’est évident et c’est voulu. Le jeu consistait à mettre en scène continuellement Adso vieux qui raconte ce qu’il se rappelle avoir vu et entendu en tant qu’Adso jeune. Mon modèle (mais je ne suis pas allé relire le livre, de lointains souvenirs me suffisaient) était le Serenus Zeitblom du Doctor Faustus. Ce double jeu énonciatif m’a fasciné et terriblement passionné. Parce que en plus, pour en revenir à ce que je disais sur le masque, en dédoublant Adso, je dédoublais une fois encore la série de cloisons, d’écrans mis entre moi en tant que personnalité biographique, ou moi en tant qu’auteur qui raconte, je narrateur, et les personnages racontés y compris la voix narrative. Je me sentais toujours plus protégé, et toute cette expérience m’a rappelé (j’ai envie de dire charnellement, avec l’évidence d’une madeleine trempée dans du tilleul) certains jeux enfantins sous les couvertures, quand je me sentais comme dans un sous-marin et que de là je lançais des messages à ma soeur, enfouie sous les couvertures d’un autre lit, tous deux isolés du monde extérieur et totalement libres d’inventer de longues courses au fond des mers silencieuses.
Adso a été très important pour moi. Dès le début, je voulais raconter toute l’histoire (avec ses mystères, ses événements politiques et théologiques, ses ambiguïtés) par la voix de quelqu’un qui traverse les événements, les enregistre avec la fidélité photographique d’un adolescent, mais qui ne les comprend pas (et qui, même vieux, ne les comprendra pas pleinement, si bien qu’il choisira une fuite dans le néant divin, qui n’était pas celle que lui avait enseignée son maître).
Faire tout comprendre par les mots de quelqu’un qui ne comprend rien. En lisant les critiques, je me rends compte que c’est l’un des aspects du roman qui a le moins impressionné les lecteurs cultivés (personne, ou presque, ne l’a relevé). Mais je me demande si cela n’a pas été un des éléments qui a déterminé la lisibilité du roman de la part de lecteurs non érudits. Ils se sont identifiés à l’innocence du narrateur, ils se sont sentis disculpés quand ils ne comprenaient pas tout. Je les ai renvoyés à leurs émois face au sexe, aux langues inconnues, aux difficultés de la pensée, aux mystères de la vie politique… Ce sont là des choses que je comprends maintenant, après coup, mais peut-être alors transférais-je sur Adso nombre de mes émois d’adolescent, surtout dans ses palpitations d’amour (avec toujours cependant la garantie de pouvoir agir par personne interposée : en effet, Adso ne vit ses souffrances d’amour qu’à travers les mots que les docteurs de l’Eglise employaient pour parler de l’amour). L’art, c’est la fuite hors de l’émotion personnelle, Joyce comme Eliot me l’avaient enseigné.
La lutte contre l’émotion fut un combat difficile. J’avais écrit une belle prière, modelée sur l’Eloge de la Nature d’Alain de Lille, à mettre dans la bouche de Guillaume, à un moment d’émotion. Et puis j’ai compris que nous nous serions émus tous les deux, moi comme auteur et lui comme personnage. Moi, en tant qu’auteur, je ne le devais pas, pour des raisons de poétique. Lui, en tant que personnage, il ne le pouvait pas, parce qu’il était fait d’une autre pâte et que ses émotions étaient toutes mentales, ou très retenues. J’ai donc éliminé cette page. Après avoir lu le livre, une amie m’a dit : « Ma seule objection, c’est que Guillaume n’a jamais un mouvement de pitié. » J’ai rapporté cela à un autre ami qui m’a répondu : « C’est bien, c’est cela le style de sa pietas. » Peut-être en était- il ainsi. Et ainsi soit-il.
La prétérition
Adso m’a servi à résoudre une autre question. J’aurais pu inscrire mon histoire dans un Moyen Age où tout le monde sait de quoi on parle. Dans une histoire contemporaine, si un personnage dit que le Vatican n’approuverait pas son divorce, il est inutile d’expliquer ce qu’est le Vatican et pourquoi il n’approuverait pas le divorce. Mais dans un roman historique, il n’en va pas de même. On raconte aussi pour éclairer les contemporains sur ce qui s’est passé et pour dire en quel sens ces événements lointains ont une importance actuelle.
On court alors le risque du « salgarisme ». Les personnages de Salgari fuient dans la forêt, traqués par des ennemis et trébuchent sur une racine de baobab : et voilà que le narrateur suspend l’action pour nous faire une leçon de botanique sur les baobabs. C’est devenu maintenant un topos, plaisant comme les vices d’une personne que l’on a aimée, mais à éviter.
J’ai récrit des centaines de pages pour échapper à cet écueil ; mais je ne me rappelle pas m’être jamais aperçu comment je résolvais le problème. Je m’en suis rendu compte deux ans après seulement, quand j’essayais de m’expliquer pourquoi le livre était lu aussi par des personnes qui ne pouvaient certes pas aimer des livres si « cultivés ». Le style narratif d’Adso est basé sur cette figure de rhétorique que l’on appelle prétérition. C’est le fameux exemple : « Je pourrais vous faire remarquer qu’elle connaissait si bien la beauté des ouvrages de l’esprit… mais pourquoi m’étendre » (Bossuet). On dit ne pas vouloir parler d’une chose que tout le monde connaît très bien, et en le disant on parle de cette chose. C’est un peu la façon dont Adso fait allusion à des personnages et des événements considérés comme bien connus, tout en en parlant. Quant à ces personnages et à ces événements que le lecteur d’Adso, allemand de la fin du siècle, ne pouvait pas connaître parce qu’ils avaient existé ou s’étaient produits en Italie au début du siècle, Adso n’a aucune réticence à en parler. Et même à le faire sur un ton didactique, parce que tel était le style du chroniqueur médiéval, tant il était désireux d’introduire des notions encyclopédiques chaque fois qu’il nommait quelque chose. Après avoir lu le manuscrit, une amie (pas la même que tout à l’heure) me dit qu’elle avait été frappée par le ton journalistique du récit, non le ton du roman, mais celui d’un article de l’Espresso, ce furent ses mots, si ma mémoire est bonne. De prime abord, je le pris assez mal, puis je compris ce qu’elle avait saisi, mais sans le reconnaître. C’est ainsi que racontent les chroniqueurs de ces siècles, et si aujourd’hui nous parlons de chronique, c’est qu’alors on en écrivait beaucoup.
Le souffle
Les longs passages didactiques avaient aussi une autre raison d’être. Après avoir lu le manuscrit, mes amis de la maison d’édition me suggérèrent de raccourcir les cent premières pages, qu’ils trouvaient trop absorbantes et fatigantes. Je n’eus aucune hésitation, je refusai. Je soutenais que si quelqu’un voulait entrer dans l’abbaye et y vivre sept jours, il devait en accepter le rythme. S’il n’y arrivait pas, il ne réussirait jamais à lire le livre dans son entier. Donc, les cent premières pages avaient une fonction pénitentielle et initiatique. Tant pis pour qui n’aimerait pas : il resterait au flanc de la colline.
Entrer dans un roman, c’est comme faire une excursion en montagne : il faut opter pour un souffle, prendre un pas, sinon on s’arrête tout de suite. C’est ce qui se passe en poésie. Et dieu qu’ils sont insupportables ces poèmes dits par des acteurs qui, pour « interpréter », ne respectent pas la mesure du vers, font des enjambements récitatifs comme s’ils parlaient en prose, suivant le contenu et non le rythme. Pour lire un poème en hendécasyllabes et tercets, il faut prendre le rythme chanté voulu par le poète. Mieux vaut réciter Dante comme si c ‘était les rimes des comptines de notre enfance que de courir à tout prix après le sens.
En narrativité, le souffle n’est pas confié aux phrases mais à des macro- propositions plus amples, à des scansions d’événements. Il est des romans qui respirent comme des gazelles et d’autres comme des baleines ou des éléphants. L’harmonie ne réside pas dans la longueur du souffle mais dans sa régularité : et si, à un moment donné, le souffle s’interrompt et qu’un chapitre (ou une séquence) s’achève avant la fin complète de la respiration, cela peut jouer un rôle très important dans l’économie du récit, marquer un point de rupture, un coup de théâtre. C’est du moins ce que font les grands auteurs : « La malheureuse répondit » — point, à la ligne — n’a pas le même rythme que « Adieu, monts », mais quand cela arrive, c’est comme si le beau ciel de Lombardie se couvrait de sang{230}. Un grand roman, c’est celui où l’auteur sait toujours à quel moment accélérer, freiner, comment doser ces coups de frein ou d’accélérateur dans le cadre d’un rythme de fond qui reste constant. En musique on peut « jouer rubato », mais point trop n’en faut, sinon on en arrive à ces mauvais exécutants qui croient que, pour faire du Chopin, il suffit de forcer sur le rubato. Je ne suis pas en train de dire comment j’ai résolu mes problèmes, mais comment je me les suis posés. Et si je devais dire que je me les posais consciemment, je mentirais. Il y a un esprit de la composition qui pense même à travers le rythme des doigts qui frappent les touches de la machine.
Je voudrais donner un exemple de cette idée que raconter, c’est penser avec les doigts. Il est évident que la scène de l’accouplement dans la cuisine est construite tout entière avec des citations de textes religieux, du Cantique des Cantiques à saint Bernard et Jean de Fécamp, en passant par sainte Hildegarde de Bingen. Qui n’a pas de pratique de la mystique médiévale mais un brin d’oreille s’est au moins aperçu de cela. Cependant, si l’on me demande maintenant de qui sont les citations, où finit l’une et où commence l’autre, je suis dans l’incapacité de le dire.
En effet, j’avais des dizaines et des dizaines de fiches avec tous les textes, parfois des pages de livre et des photocopies, beaucoup plus que je n’en ai utilisé par la suite. Mais quand j’ai écrit la scène, je l’ai fait d’un seul jet (ce n’est qu’après que je l’ai polie, comme si j’y avais passé un vernis homogénéisateur pour atténuer les raccords). Donc, j’écrivais, à côté de moi j’avais tous les textes épars et je jetais un coup d’oeil tantôt sur l’un, tantôt sur l’autre, copiant un passage puis le reliant aussitôt à un autre. C’est le chapitre que j’ai, à la première rédaction, écrit le plus rapidement. J’ai compris, après, que j’essayais de suivre des doigts le rythme de l’accouplement, et que par conséquent je ne pouvais m’arrêter pour choisir la bonne citation. Ce qui rendait juste la citation que j’insérais à ce moment-là, c’était le rythme avec lequel je l’insérais, j’écartais des yeux celles qui auraient cassé le rythme de mes doigts. Je ne peux pas dire que la rédaction de l’événement ait duré autant que l’événement (bien qu’il y ait des accouplements très longs), mais j’ai essayé d’abréger au maximum la différence entre temps de l’accouplement et temps de l’écriture. Et j’entends écriture non pas au sens barthesien, mais bien au sens dactylographique, je parle de l’écriture comme acte matériel, physique. Et je parle de rythmes du corps, pas d’émotions. L’émotion, désormais filtrée, existait au tout début, dans ma décision d’assimiler extase mystique et extase érotique, dans le moment où j’avais lu et choisi les textes à utiliser. Après, plus aucune émotion, c’était Adso qui faisait l’amour, pas moi ; moi, je devais seulement traduire son émotion dans un jeu d’yeux et de doigts, comme si j’avais décidé de raconter une histoire d’amour en jouant du tambour.
Construire le lecteur
Rythme, souffle, pénitence… Pour qui, pour moi ? Non, bien sûr, pour le lecteur. On écrit en pensant à un lecteur. Tout comme le peintre peint en pensant au spectateur du tableau. Après avoir donné un coup de pinceau, il recule de deux ou trois pas et étudie l’effet : il regarde le tableau comme devrait le regarder, dans des conditions de lumière appropriée, le spectateur quand il l’admirera, accroché au mur. Quand l’oeuvre est finie, le dialogue s’instaure entre le texte et ses lecteurs (l’auteur est exclu). Au cours de l’élaboration de l’oeuvre, il y a un double dialogue : celui entre ce texte et tous les autres textes écrits auparavant (on ne fait des livres que sur d’autres livres et autour d’autres livres) et celui entre l’auteur et son lecteur modèle. J’ai théorisé cela dans des ouvrages comme Lector in fabula ou avant encore dans l’OEuvre ouverte, et ce n’est pas moi qui l’ai inventé.
Il se peut que l’auteur écrive en pensant à un certain public empirique, comme le faisaient les fondateurs du roman moderne, Richardson, Fielding ou Defoe, qui écrivaient pour les marchands et leurs femmes ; mais Joyce aussi écrit pour un public, lui qui pense à un lecteur idéal atteint d’une insomnie idéale. Dans les deux cas, que l’on croie s’adresser à un public qui est là, devant la porte, prêt à payer, ou que l’on se propose d’écrire pour un lecteur à venir, écrire c’est construire, à travers le texte, son propre modèle de lecteur.
Que signifie penser à un lecteur capable de surmonter l’écueil pénitentiel des cent premières pages ? Cela veut exactement dire écrire cent pages dans le but de construire un lecteur adéquat pour celles qui suivront.
Y a-t-il un écrivain qui écrive pour la seule postérité ? Non, même s’il l’affirme, parce que, comme il n’est pas Nostradamus, il ne peut se représenter la postérité que sur le modèle de ce qu’il sait de ses contemporains. Y a-t-il un auteur qui écrive pour peu de lecteurs ? Oui, si par là on entend que le Lecteur Modèle qu’il se représente a, dans ses prévisions, peu de chances d’être incarné par la majorité. Mais, même dans ce cas, l’auteur écrit avec l’espoir, pas si secret que ça, que son livre crée le nombre, qu’il y ait beaucoup de nouveaux représentants de ce lecteur désiré et recherché avec tant de méticulosité artisanale, postulé et encouragé par son texte.
La différence, s’il y en a une, peut résider entre le texte qui veut produire un lecteur nouveau et celui qui cherche à aller à la rencontre des désirs des lecteurs de la rue. Dans le second cas, nous avons un livre écrit et construit selon une recette pour produits de série, l’auteur faisant une sorte d’analyse de marché et s’y adaptant. Ce travail à coups de formule se révèle à l’analyse sur une longue distance : on examine les différents romans écrits et l’on remarque que dans tous, après avoir changé les noms, les lieux et les physionomies, l’auteur raconte toujours la même histoire. Celle que le public demandait déjà.
Mais quand l’écrivain opte pour le nouveau et projette un lecteur différent, il ne se veut pas analyste de marché faisant la liste des demandes exprimées, mais philosophe qui entrevoit intuitivement les trames du Zeitgeist. Il veut révéler à son public ce que celui-ci devrait vouloir, même s’il ne le sait pas. Il veut révéler le lecteur à lui-même.
Si Manzoni avait voulu écouter la demande du public, il avait une formule toute prête : le roman historique de l’époque médiévale, avec des personnages illustres, comme dans la tragédie grecque, des rois et des princesses (n’est-ce pas ce qu’il fait dans l’Adelchi ?), de grandes et nobles passions, des entreprises guerrières et la célébration des gloires italiques en un temps où l’Italie était terre des forts. N’en ont-ils pas fait autant, avant lui, avec lui et après lui, tous ces romanciers historiques plus ou moins malheureux, de l’artisan d’Azeglio au fougueux et vaseux Guerrazzi, en passant par l’illisible Cantù ?
Et que fait Manzoni au contraire ? Il choisit le XVIIe siècle : et une époque d’esclavage, et des personnages vils, et un spadassin, un seul mais félon, et pas de batailles racontées, et le choix courageux d’alourdir son histoire avec des documents et des cris… Et ça plaît, ça plaît à tout le monde, érudits et incultes, grands et humbles, bigots et mangeurs de curés. Parce qu’il avait senti que les lecteurs de son temps devaient avoir cela, même s’ils ne le savaient pas, même s’ils ne le demandaient pas, même s’ils ne croyaient pas que ce fût consommable. Et que de travail, à coups de lime, de scie et de marteau, de lavage et de toilettage, pour rendre son produit doux au palais ! Pour obliger les lecteurs empiriques à devenir le lecteur modèle qu’il avait désiré.
Manzoni n’écrivait pas pour plaire au public tel qu’il était mais pour créer un public auquel son roman ne pouvait pas ne pas plaire. Et malheur s’il n’avait pas plu. Voyez l’hypocrisie et la sérénité avec laquelle il parle de ses vingt-cinq lecteurs. Vingt-cinq millions, il en voulait.
Quel lecteur modèle voulais-je quand j’écrivais ? Un complice, bien sûr, qui joue mon jeu. Je voulais devenir complètement médiéval et vivre le Moyen Age comme si c’était mon époque (et vice versa). Mais en même temps, je voulais de toutes mes forces que se dessine une figure de lecteur qui, après avoir surmonté l’initiation, devienne ma proie ou la proie du texte et pense ne plus vouloir autre chose que ce que le texte lui offrait. Un texte veut être une expérience de transformation pour son lecteur. Tu crois vouloir du sexe, et des trames criminelles où à la fin on découvre le coupable, et beaucoup d’action, mais en même temps tu aurais honte d’accepter une véritable pacotille faite de Fiacre n° 13 et du Forgeron de la Court-Dieu. Eh bien, moi, je te donnerai du latin, et peu de femmes, et de la théologie à gogo et du sang par litres comme au
Grand Guignol, afin que tu t’écries : « Mais c’est faux ! je ne joue plus ! » Alors, alors tu devras être mien, tu éprouveras le frisson de l’infinie toute-puissance divine qui rend vain l’ordre du monde. Et puis, si tu es doué, tu t’apercevras de la façon dont je t’ai attiré dans le piège : après tout, je te le disais à chaque pas, je t’avertissais bien que je t’entraînais vers la damnation, mais le beau des pactes avec le Diable, c’est qu’on les signe en sachant parfaitement avec qui on traite. Sinon, pourquoi être récompensé par l’Enfer ?
Et puisque je voulais que soit considérée comme agréable la seule chose qui nous fasse frémir, à savoir le frisson métaphysique, il ne me restait plus qu’à choisir (parmi les modèles de trames) celle qui est la plus métaphysique et philosophique, le roman policier.
La métaphysique policière
Ce n’est pas un hasard si le livre débute comme un polar (et si, jusqu’à la fin, il dupe le lecteur naïf au point que celui-ci peut ne pas s’apercevoir qu’il s’agit d’un policier où l’on ne découvre presque rien et où le détective est tenu en échec). Je crois que les gens aiment les polars non parce qu’il y a des assassinats ni parce que l’on y célèbre le triomphe de l’ordre final (intellectuel, social, légal et moral) sur le désordre de la faute. Si le roman policier plaît, c’est qu’il représente une histoire de conjecture à l’état pur. Mais un diagnostic médical, une recherche scientifique, une interrogation métaphysique sont aussi des cas de conjecture. Au fond, la question de base de la philosophie (comme de la psychanalyse) est la même que celle du roman policier : à qui la faute ? Pour le savoir (pour croire le savoir) il faut présumer que tous les faits ont une logique, la logique que leur a imposée le coupable. Chaque histoire d’enquête et de conjecture nous raconte une chose auprès de laquelle nous habitons depuis toujours (citation pseudo-heideggérienne). On comprend alors clairement pourquoi mon histoire de base (qui est l’assassin ?) se ramifie en tant d’autres histoires, toutes des histoires d’autres conjectures, toutes tournant autour de la conjecture en tant que telle.
Le monde abstrait de la conjecture, c’est le labyrinthe. Et il y a trois types de labyrinthe. Le premier est grec, c’est celui de Thésée. Il ne permet à personne de s’égarer : vous entrez et vous arrivez au centre, puis vous allez du centre à la sortie. C’est pourquoi au centre, il y a le Minotaure, sinon l’histoire perdrait toute sa saveur, ce serait une simple promenade de santé. Oui, mais vous ne savez pas où vous allez arriver, ni ce que fera le Minotaure. Et la terreur naîtra peut-être. Mais si vous déroulez le labyrinthe classique, vous vous retrouvez avec un fil à la main, le fil d’Ariane. Le labyrinthe classique, c’est le fil d’Ariane de soi-même.
Le second est le labyrinthe maniériste : si vous le mettez à plat, vous avez entre les mains une espèce d’arbre, une structure en forme de racines, avec de nombreuses impasses. La sortie est unique mais vous pouvez vous tromper. Vous avez besoin d’un fil d’Ariane pour ne pas vous perdre. Ce labyrinthe est un modèle de trial-and-error process.
Enfin, il y a le réseau, ou ce que Deleuze et Guattari appellent rhizome. Le rhizome est fait de telle sorte que chaque chemin peut se connecter à chaque autre chemin. Il n’a pas de centre, pas de périphérie, pas de sortie parce qu’il est potentiellement infini. L’espace de la conjecture est un espace en rhizome. Le dédale de ma bibliothèque est encore un labyrinthe maniériste, mais le monde où Guillaume s’aperçoit qu’il vit est déjà structuré en rhizome : il est structurable mais jamais définitivement structuré.
Un jeune garçon de dix-sept ans m’a dit qu’il n’avait rien compris aux discussions théologiques mais qu’elles agissaient comme des prolongements du labyrinthe spatial (comme si c’était une musique thrilling dans un film de Hitchcock). Et je crois bien qu’il s’est produit quelque chose de ce genre : même le lecteur naïf a flairé qu’il se trouvait face à une histoire de labyrinthe, mais où les labyrinthes n’étaient pas spatiaux. Ainsi, curieusement, les lectures les plus naïves étaient les plus « structurales ». Le lecteur naïf est entré en contact direct, sans la médiation des contenus, avec le fait qu’il est pensé que, malgré tout, un roman doit divertir aussi et surtout à travers la trame.
Si un roman divertit, il obtient l’approbation d’un public. Or, pendant un certain temps, on a pensé que cette approbation était un indice négatif. Si un roman rencontre la faveur du public, c’est qu’il ne dit rien de nouveau et qu’il donne au public ce que celui-ci attendait déjà.
Je crois pourtant qu’il est différent de dire « si un roman donne au lecteur ce qu’il attendait, il reçoit son approbation » et « si un roman reçoit l’approbation du lecteur c’est parce qu’il lui donne ce qu’il attendait ».
La seconde affirmation n’est pas toujours vraie. Il suffit de penser à Defoe ou à Balzac, pour en arriver au Tambour ou à Cent ans de solitude.
On dira que l’équation « approbation = valeur négative » a été encouragée par certaines positions polémiques prises par nous, ceux du groupe 63, et même avant 1963, quand on identifiait le livre à succès au livre commercial et le roman commercial au roman à intrigue, alors qu’on célébrait l’oeuvre expérimentale qui fait scandale et qui est refusée par le grand public. Tout cela a été dit et cela avait un sens de le dire. Ce sont ces choses qui ont le plus scandalisé les lettrés bien-pensants, ce sont celles que les chroniqueurs n’ont jamais oubliées, précisément parce qu’elles étaient formulées pour obtenir cet effet-là, en pensant aux romans traditionnels fondamentalement commerciaux et dépourvus de la moindre innovation intéressante eu égard à la problématique du XIXe.
Alors fatalement, des coalitions se formèrent, on fit flèche de tout bois, parfois pour des raisons de guerre de clans. Je me souviens que nos ennemis étaient Lampedusa, Bassani et Cassola. Aujourd’hui, j’introduirais de subtiles différences entre eux. Lampedusa avait écrit un bon roman hors du temps, et nous polémiquions contre la célébration qui en était faite comme s’il ouvrait une nouvelle voie à la littérature italienne, quand au contraire il en fermait glorieusement une autre. Je n’ai pas changé d’avis sur Cassola. Sur Bassani, en revanche, je serais beaucoup, mais beaucoup plus prudent et si j’étais en 1963, je l’accepterais volontiers comme compagnon de route. Mais là n’est pas le problème dont je veux parler.
Le problème, c’est que tout le monde a oublié ce qui s’est passé en 1965 quand, de nouveau, le groupe s’est réuni à Palerme pour débattre du roman expérimental (et dire que les actes figurent encore au catalogue Feltrinelli, sous le titre II romanzo sperimentale, avec deux dates : 1965 en couverture, achevé d’imprimé en 1966).
Or, ce débat fourmillait d’idées intéressantes. D’abord, le rapport initial de Renato Barilli, alors théoricien de tous les expérimentalismes du Nouveau Roman, qui à cette époque réglait ses comptes avec le nouveau Robbe-Grillet, avec Grass et Pynchon (n’oublions pas que Pynchon est aujourd’hui cité parmi les initiateurs du post-moderne, mais ce mot n’existait pas alors, du moins en Italie ; John Barth faisait ses débuts en Amérique) ; et Barilli citait Roussel redécouvert, qui aimait Verne, et il ne citait pas Borges parce que sa réhabilitation n’avait pas encore commencé. Et que disait-il, Barilli ? Il disait que jusqu’alors on avait privilégié la fin de l’intrigue et le blocage de l’action dans l’épiphanie et dans l’extase matérialiste, mais que s’ouvrait une nouvelle phase de la narrativité, avec la revalorisation de l’action, fût-ce d’une action autre.
Moi, j’analysais l’impression que nous avions éprouvée le soir précédent en assistant à un curieux collage cinématographique de Baruchello et Grifi, Verifica incerta, une histoire faite de morceaux d’histoires, de situations standard, de topoi du cinéma commercial. Et je remarquais que là où le public avait réagi avec le plus de plaisir, c’était les points où, quelques années auparavant, il aurait été scandalisé, c’est-à- dire là où les conséquences logiques et temporelles étaient éludées et où ses attentes semblaient être violemment frustrées. L’avant-garde se faisait tradition, les dissonances d’autrefois se faisaient miel pour les oreilles et les yeux. Une seule conclusion s’imposait : l’inacceptabilité du message n’était plus le critère roi pour une narrativité (pour tout art) expérimentale, car l’inacceptable était désormais codifié comme aimable. Un retour concerté à de nouvelles formes d’acceptable et d’aimable se profilait. Et je rappelais que si au temps des soirées futuristes de Marinetti, il était indispensable que le public sifflât, « aujourd’hui au contraire, la polémique qui consiste à considérer qu’une expérience est un échec par le simple fait qu’elle est acceptée comme normale est sotte et improductive : c’est se référer au schéma axiologique de l’avant-garde historique, et l’éventuel critique avangardiste n’est autre qu’un “marinettien” attardé. Répétons que l’inacceptabilité du message pour le récepteur n’est devenue une garantie de valeur qu’au cours d’une période historique très précise… Peut-être nous faudra-t-il renoncer à cette arrière-pensée qui domine constamment tous nos débats, à savoir que le scandale devrait être la preuve de la validité d’un travail. La dichotomie entre ordre et désordre, entre oeuvre de consommation et oeuvre de provocation, tout en ne perdant rien de sa valeur, devra elle aussi être réexaminée sous un autre angle : je crois qu’il sera possible de trouver des éléments de rupture et de contestation dans des oeuvres qui apparemment sont de consommation facile, et de s’apercevoir en revanche que certaines oeuvres, qui semblent provocatrices et font encore bondir le public, ne contestent absolument rien… Ces jours-ci, j’ai rencontré quelqu’un qui était envahi de soupçons et de doute parce qu’un produit lui avait trop plu… » Et ainsi de suite.
1965. C’était le début du pop-art, et donc les années où les distinctions traditionnelles entre art expérimental, non figuratif, et art de masse, narratif et figuratif, devenaient caduques. Les années où Pousseur, parlant des Beatles, me disait : « Ils travaillent pour nous », sans s’apercevoir qu’il travaillait pour eux (et Cathy Berberian allait venir qui nous montrerait que les Beatles, arrivés à Purcell, comme il se devait, pouvaient être interprétés en concert, aux côtés de Monteverdi et Satie).
Le post-moderne, l’ironie, l’aimable
Depuis 1965, deux idées se sont définitivement clarifiées. On pouvait retrouver l’intrigue sous forme de citation d’autres intrigues, et la citation pouvait être moins conventionnelle et commerciale que l’intrigue citée (1972 : ce sera l’almanach Bompiani, consacré au Retour de l’intrigue, où Ponson du Terrail et Eugène Sue seront revisités d’une manière tout à la fois ironique et éblouie, où certaines grandes pages de Dumas forceront l’admiration, à peine teintée d’ironie). Pouvait-on avoir un roman commercial, assez problématique, et pourtant aimable ?
Cette soudure, ces retrouvailles avec l’intrigue et l’amabilité, les théoriciens américains du post-modernisme allaient l’accomplir.
Malheureusement, « post-moderne » est un terme bon à tout faire (et je pense à post-moderne comme catégorie littéraire proposée par les critiques américains, non à la notion plus générale de Lyotard). J’ai l’impression qu’aujourd’hui on l’applique à tout ce qui plaît à celui qui en use. Il semble, d’autre part, qu’il y ait une tentative de lui faire subir un glissement rétroactif : avant, ce terme s’adaptait à quelques écrivains ou artistes de ces vingt dernières années, petit à petit on est remonté au début du siècle, puis toujours plus en arrière, et bientôt cette catégorie arrivera à Homère.
Je crois cependant que le post-moderne n’est pas une tendance que l’on peut délimiter chronologiquement, mais une catégorie spirituelle, ou mieux un Kunstwollen, une façon d’opérer. On pourrait dire que chaque époque a son post-moderne, tout comme chaque époque aurait son maniérisme (si bien que je me demande si post-moderne n’est pas le nom moderne du maniérisme en tant que catégorie méta-historique). Je crois qu’à toute époque on atteint des moments de crise tels que ceux qu’a décrits Nietzsche dans les Considérations inactuelles sur le danger des études historiques. Le passé nous conditionne, nous harcèle, nous rançonne. L’avant-garde historique (mais ici aussi j’entendrais la catégorie d’avant-garde comme catégorie méta-historique) essaie de régler ses comptes avec le passé. « A bas le clair de lune », mot d’ordre futuriste, est le programme typique de toute avant-garde, il suffit de remplacer clair de lune par quelque chose d’approprié. L’avant-garde détruit le passé, elle le défigure : les Demoiselles d’Avignon, c’est le geste typique de l’avant-garde. Et puis l’avant-garde ira plus loin, après avoir détruit la figure, elle l’annule, elle en arrive à l’abstrait, à l’informel, à la toile blanche, à la toile lacérée, à la toile brûlée ; en architecture, ce sera la condition minimum du curtain wall, l’édifice comme stèle, parallélépipède pur ; en littérature, ce sera la destruction du flux du discours, jusqu’au collage à la Burroughs, jusqu’au silence, jusqu’à la page blanche ; en musique, ce sera le passage de l’atonalité au bruit, au silence absolu (en ce sens, le Cage des origines est moderne).
Mais vient un moment où l’avant-garde (le moderne) ne peut pas aller plus loin, parce que désormais elle a produit un métalangage qui parle de ses impossibles textes (l’art conceptuel). La réponse post- moderne au moderne consiste à reconnaître que le passé, étant donné qu’il ne peut être détruit parce que sa destruction conduit au silence, doit être revisité : avec ironie, d’une façon non innocente. Je pense à l’attitude post- moderne comme à l’attitude de celui qui aimerait une femme très cultivée et qui saurait qu’il ne peut lui dire : « Je t’aime désespérément » parce qu’il sait qu’elle sait (et elle sait qu’il sait) que ces phrases, Barbara Cartland les a déjà écrites. Pourtant, il y a une solution. Il pourra dire : « Comme dirait Barbara Cartland, je t’aime désespérément. » Alors, en ayant évité la fausse innocence, en ayant dit clairement que l’on ne peut parler de façon innocente, celui-ci aura pourtant dit à cette femme ce qu’il voulait lui dire : qu’il l’aime et qu’il l’aime à une époque d’innocence perdue. Si la femme joue le jeu, elle aura reçu une déclaration d’amour. Aucun des deux interlocuteurs ne se sentira innocent, tous deux auront accepté le défi du passé, du déjà dit que l’on ne peut éliminer, tous deux joueront consciemment et avec plaisir au jeu de l’ironie… Mais tous deux auront réussi une fois encore à parler d’amour.
Ironie, jeu métalinguistique, énonciation au carré. De sorte que si, avec le moderne, ne pas comprendre le jeu, c’est forcément le refuser, avec le post-moderne, on peut ne pas comprendre le jeu et prendre les choses au sérieux. Ce qui est d’ailleurs la qualité (le risque) de l’ironie. Il y a toujours des gens pour prendre au sérieux le discours ironique. Je pense que les collages de Picasso, de Juan Gris et de Braque étaient modernes : c’est pourquoi les gens normaux ne les acceptaient pas. En revanche, les collages que faisait Max Ernst, ces montages de morceaux de gravures du XIXe, étaient post-modernes : on peut aussi les lire comme un récit fantastique, comme le récit d’un rêve, sans s’apercevoir qu’ils représentent un discours sur la gravure et peut-être sur le collage lui- même. Si le post-moderne c’est cela, on comprend alors pourquoi Sterne ou Rabelais étaient post-modernes, pourquoi Borges l’est certainement, pourquoi dans un même artiste peuvent cohabiter, ou se succéder rapidement, ou alterner, le moment moderne et le moment post- moderne. Voyez Joyce. Le Portrait est l’histoire d’une tentative moderne. Les Dubliners, même s’ils sont antérieurs, sont plus modernes que le Portrait. Ulysses est à la limite. Finnegans Wake est déjà post- moderne, ou, du moins, il ouvre le discours post-moderne, il requiert, pour être compris, non point la négation du déjà dit mais une nouvelle réflexion ironique.
On a déjà presque tout dit sur le post-moderne, dès le début (c’est-à- dire à partir d’essais comme « la Littérature de l’épuisement » de John Barth, qui date de 1967 et qui a été récemment publié dans le numéro 7 de Calibano sur le post-moderne américain). Ce n’est pas que je sois totalement d’accord avec les bons points que les théoriciens du post- modernisme (Barth y compris) distribuent aux écrivains et aux artistes, en établissant qui est post-moderne et qui ne l’est pas encore. Ce qui m’intéresse, c’est le théorème que les théoriciens de la tendance tirent de leurs prémisses : « Mon écrivain post-moderne idéal n’imite et ne répudie ni ses parents du XXe ni ses grands-parents du XIXe. Il a digéré le modernisme, mais il ne le porte pas sur ses épaules, comme un poids… Peut-être cet écrivain ne peut-il pas espérer atteindre ou émouvoir les amateurs de James Michener et Irving Wallace, sans parler des analphabètes lobotomisés par les mass media, mais il devrait espérer toucher et divertir, quelquefois au moins, un public plus vaste que le cercle de ceux que Thomas Mann appelait les premiers chrétiens, les dévots de l’Art… Le roman post-moderne idéal devrait dépasser les querelles entre réalisme et irréalisme, formalisme et contenuisme, littérature pure et littérature de l’engagement, narrativité d’élite et narrativité de masse… Je préfère l’analogie avec le bon jazz ou avec la musique classique : en réécoutant ou en analysant une partition, on découvre une foule de choses que l’on n’avait pas saisies la première fois, mais la première fois doit savoir vous ravir au point de vous faire désirer la réécouter, ceci étant valable pour les spécialistes comme pour les profanes. » (Barth, en 1980, qui reprend ce thème, cette fois sous le titre « la littérature de la plénitude ».) Bien entendu, le discours peut être repris avec un plus grand goût du paradoxe, ce que fait Leslie Fiedler, dans un essai de 1981 et dans un débat récent sur Salmagundi avec d’autres auteurs américains. Fiedler fait de la provocation, c’est évident. Il glorifie le Dernier des Mohicans, la narrativité d’aventure, le Gothic, toute cette masse d’écrits, méprisés par les critiques, qui a su créer des mythes et peupler l’imaginaire de plus d’une génération. Il se demande si on publiera de nouveau quelque chose comme la Case de l’Oncle Tom qui puisse être lu avec une égale passion à la cuisine, au salon et dans la chambre des enfants. Il met Shakespeare du côté de ceux qui savaient divertir, dans le même sac qu’Autant en emporte le vent. Nous savons tous que c’est un critique trop fin pour y croire. Il veut simplement abattre cette barrière érigée entre art et amabilité. Il comprend intuitivement que toucher un vaste public et peupler ses rêves, c’est peut- être cela aujourd’hui faire de l’avant-garde et que cela nous laisse encore libres de dire que peupler les rêves des lecteurs ne signifie pas nécessairement les bercer. Ça peut vouloir dire les obséder.
Le roman historique
Depuis deux ans, je refuse de répondre à des questions oiseuses. Du style : ton oeuvre est-elle une oeuvre ouverte ou pas ? Mais est-ce que je sais, moi ! C’est votre affaire, pas la mienne ! Ou alors : auquel de tes personnages t’identifies-tu ?
Mon Dieu, mais à qui s’identifie un auteur ? Aux adverbes, bien sûr.
La question la plus oiseuse de toutes est celle de ceux qui suggèrent que raconter le passé c’est une façon de fuir le présent. Est-ce vrai ? me demandent-ils. C’est probable, dis-je ; si Manzoni a raconté le XVIIe siècle, c’est que le XIXe ne l’intéressait pas ; le Sant’Ambrogio de Giusti parle aux Autrichiens de son époque, alors qu’évidemment le Giuramento de Pontida de Berchet parle des fables du temps jadis. Love Story est de son temps, alors que la Chartreuse de Parme ne raconte que des événements survenus vingt-cinq ans plus tôt…
A quoi bon dire que tous les problèmes de l’Europe moderne se forment, tels que nous les ressentons aujourd’hui, au Moyen Age, de la démocratie des communes à l’économie bancaire, des monarchies nationales aux cités, des nouvelles technologies aux révoltes des paysans : le Moyen Age est notre enfance à laquelle il nous faut toujours revenir pour faire une anamnèse. Mais on peut aussi parler du Moyen Age dans le style d’Excalibur. Et donc, le problème est ailleurs, et on ne peut l’éluder. Que veut dire écrire un roman historique ? Je crois qu’il y a trois façons de raconter sur le passé. L’une est le romance, du cycle breton aux histoires de Tolkien, où l’on trouve aussi la « Gothic novel » qui n’a rien de la novel et tout du romance. Le passé est alors scénographie, prétexte, construction de la fable et donne libre cours à l’imagination. Pour sa part, la science-fiction est souvent un pur romance. Le romance, c’est l’histoire d’un ailleurs.
Puis vient le roman de cape et d’épée, comme celui de Dumas. Le roman de cape et d’épée se choisit un passé « réel » et reconnaissable : pour y parvenir, il le peuple de personnages déjà enregistrés par l’encyclopédie (Richelieu, Mazarin) auxquels il fait accomplir des actions que l’encyclopédie n’enregistre pas (avoir rencontré Milady, avoir eu des contacts avec un certain Bonacieux) mais qui ne la contredisent pas. Naturellement, pour corroborer l’impression de réalité, les personnages historiques feront aussi (avec l’assentissement de l’historiographie) ce qu’ils ont fait (assiéger La Rochelle, avoir eu des relations intimes avec Anne d’Autriche, avoir eu affaire avec la Fronde). Dans ce cadre (« vrai »), viennent s’insérer les personnages de fiction ; cependant, ceux- ci manifestent des sentiments qui pourraient être attribués à des personnages d’autres époques. Ce que d’Artagnan fait en récupérant à Londres les bijoux de la Reine, il aurait pu le faire aussi bien au XVIe qu’au XVIIIe siècle. Il n’est pas nécessaire de vivre au XVIIe pour avoir la psychologie de d’Artagnan.
Par contre, dans le roman historique il n’est pas obligatoire qu’entrent en scène des personnages reconnaissables en termes d’encyclopédie commune. Dans les Fiancés, le personnage le plus connu est le cardinal Federigo, qu’avant Manzoni très peu de gens connaissaient (l’autre Borromée, saint Charles, était bien plus connu). Mais tout ce que font Renzo, Lucia ou Fra Cristoforo ne pouvait qu’être accompli dans la Lombardie du XVIIe siècle. Les agissements des personnages servent à faire mieux comprendre l’histoire, ce qui s’est passé, et bien qu’ils soient inventés, ils en disent plus, et avec une clarté sans pareille, sur l’Italie de l’époque, que les livres d’histoire consacrés.
En ce sens, je voulais certainement écrire un roman historique, non parce qu’Ubertin ou Michel avaient vraiment existé et disaient plus ou moins ce qu’ils avaient vraiment dit, mais parce que tout ce que disaient des personnages fictifs comme Guillaume aurait dû être dit à cette époque-là.
Je ne sais pas à quel point j’ai été fidèle à ce propos. Je ne crois pas à quelque manquement de ma part quand je déguisais des citations d’auteurs postérieurs (comme Wittgenstein) en les faisant passer pour des citations de l’époque. En ce cas, je savais très bien que ce n’étaient pas mes médiévaux qui étaient modernes, mais plutôt les modernes qui pensaient médiéval. Pourtant, je me demande si parfois je n’ai pas prêté à mes personnages fictifs une capacité d’assembler, à partir des disiecta membra de pensées totalement médiévales, certaines chimères conceptuelles que, comme telles, le Moyen Age n’aurait pas reconnues siennes. Mais je crois qu’un roman historique doit aussi faire cela : il doit déterminer dans le passé les causes de ce qui est advenu après, mais aussi dessiner le processus par lequel ces causes ont évolué lentement pour produire leurs effets.
Si un de mes personnages, en comparant deux idées médiévales, en tire une troisième idée plus moderne, il fait exactement ce que la culture a fait par la suite, et si personne n’a jamais écrit ce qu’il dit, il est certain que quelqu’un, fût-ce d’une façon confuse, aurait dû commencer à le penser (même sans le dire, pris par dieu sait quelles craintes et pudeurs).
En tout cas, il est une chose qui m’a beaucoup amusé chaque fois qu’un critique ou un lecteur a écrit ou dit qu’un de mes personnages affirmait des choses trop modernes, et bien, dans tous les cas, dans ceux- là justement, j’avais utilisé des citations textuelles du XIVe siècle.
Et il y a des pages où le lecteur a savouré comme délicieusement médiévales des attitudes que moi je ressentais comme illégitimement modernes. C’est que chacun a sa propre idée, souvent corrompue, du Moyen Age. Nous seuls, moines d’alors, savons la vérité. Mais la dire nous conduirait au bûcher.
Pour finir
J’ai retrouvé — deux ans après avoir écrit le roman — des notes datées de 1953.
« Horace et son ami font appel au comte de P. pour résoudre le mystère du spectre. Comte de P., gentilhomme excentrique et flegmatique. En revanche, un jeune capitaine des gardes danoises qui use de méthodes américaines. Développement normal de l’action selon les lignes de la tragédie. Au dernier acte, le comte de P., ayant réuni sa famille, explique le mystère : l’assassin est Hamlet. Trop tard, Hamlet meurt. »
Des années après, j’ai découvert que Chesterton avait eu quelque part une idée de ce genre. Il paraît que le groupe de l’Oulipo a récemment construit une matrice de toutes les situations policières possibles et a trouvé qu’il reste à écrire un livre : celui où l’assassin serait le lecteur.
Morale : il existe des idées obsédantes, elles ne sont jamais personnelles, les livres parlent entre eux, et une véritable enquête policière doit prouver que les coupables, c’est nous.