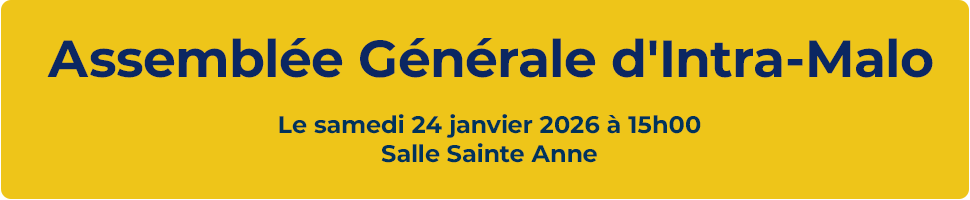Présentation du film
Bonsoir à tous,
Le film que vous allez voir ce soir est une comédie musicale américaine produite en 1952. Beaucoup d’entre vous l’ont certainement déjà vu tant le film est célèbre.
La mise en scène est de Stanley Donen et Gene Kelly, avec pour acteurs principaux Gene Kelly (rôle de Don Lockwood), Donald O’Connor (Cosmo Brown) et Debbie Reynolds (Kathy Selden).
Stanley Donen (1924 – 2019) fut le metteur en scène de plusieurs comédies musicales mais aussi de Drôle de frimousse (Funny Face) avec Audrey Hepburn et Fred Astaire, de Charade, avec Audrey Hepburn et Cary Grant, et de l’insolite Staircase (L’escalier), tourné en 1969 avec Rex Harrison et Richard Burton dans le rôle d’un couple de coiffeurs homosexuels vieillissants qui se déchirent à longueur de journée.
Quant à Gene Kelly, c’est l’inoubliable danseur, chanteur, acteur et réalisateur de multiples comédies musicales des années cinquante. Citons sa participation aux films à succès que furent Le pirate, Un Américain à Paris, Brigadoon, Un jour à New-York, Hello Dolly, Les Girls et des irrésistibles Trois Mousquetaires de George Sidney (1948). Des extraits de ce dernier film sont d’ailleurs utilisés dans plusieurs séquences de Singin’ in the rain.
Alors que Gene Kelly était déjà une star au moment du tournage, Debbie Reynolds n’était qu’une jeune actrice totalement inexpérimentée en matière de danse. C’est grâce à l’entraînement reçu de Gene Kelly et ses assistants qu’elle put assumer son rôle dans ce domaine. Sa fraîcheur et son charme firent le reste, et elle fut choisie en concurrence avec Judy Garland, Kathryn Grayson, Leslie Caron et June Allyson. Mentionnons« une anecdote selon laquelle Stanley Donen demande si elle savait danser et Kelly répond « ça n’a aucune importance et qu’il lui apprendra, la jeune femme étant si parfaite pour le rôle qu’elle justifie des altérations de la chorégraphie ».
Le troisième larron, Donald O’Connor, est moins connu, mais sa performance dans le film est brillante. Ses qualités de danseur et d’acteur comique ne peuvent s’oublier. Son numéro Make ‘Em laugh (Faites les rire) est resté un morceau d’anthologie. De façon continuelle, Cosmo apparaît comme celui qui commente ironiquement l’action, il est la conscience décalée de ce qui se passe. Ses répliques, qui reprennent à la lettre ce qu’il entend, sont très proches de celles des Marx Brothers et de leur art de la dérision.
Le scénario du film fut l’œuvre du célèbre duo formé par Betty Comden et Adolph Green, qu’on a pu qualifier (https ://web.archive.org/web/20101023061431/http ://songwritershalloffame.org/exhibits/C59) de « longest running creative partnership in theatre history », du plus durable partenariat créatif dans l’histoire théâtrale : leur collaboration embrassa six décennies. Comden et Green sont notamment les auteurs de On the town(mise en scène de Stanley Donen) et de Wonderful town (mise en scène de George Abbott) avec la musique de Leonard Bernstein, et Green est célèbre également comme acteur et chanteur, par exemple dans le rôle du Docteur Pangloss dans Candide, l’opérette de Bernstein conçue d’après le roman de Voltaire. Pour Singin’ in the rain, le défi à relever par le duo était de reprendre une collection disparate de chansons préexistantes et de construire autour d’elles une histoire qui tienne la route. Leur surprenante réussite est d’avoir créé la grande unité esthétique et narrative d’un film qui s’annonçait comme une sorte de patchwork à base de pièces rapportées. La quasi-totalité des chansons préexistaient, notamment écrites par Arthur Freed comme parolier et par Nacio Herb Brown comme compositeur. À plusieurs reprises, Comden et Green avaient failli jeter l’éponge, mais ils furent constamment encouragés par leurs amis Gene Kelly et Stanley Donen.
Le producteur et parolier était Arthur Freed, dont la production cinématographique a totalisé 21 Oscars et rapporté plus de 280 millions de dollars de bénéfice. Sa grande spécialité était la comédie musicale, qui lui doit énormément. Freed exerçait sa profession de producteur pour le compte de la MGM. Son activité a duré de 1929 à 1962. À l’époque de la sortie du film, la MGM n’était plus dirigée par Louis B. Mayer, qui avait du démissionner en 1951 en raison de profits déclinants au profit de Dore Schary comme chef de production. C’est ce dernier qui a dirigé la production du film. Arthur Freed est moqué dans le film par le personnage de R. F. Simpson qui reprend certaines de ses expressions (comme quoi il avait bon caractère).
Le film ne rencontra à sa sortie qu’un modeste succès, et n’obtint aucun Oscar, par contraste avec Un Américain à Paris sorti quelques mois plus tôt (octobre et novembre 1951 contre avril 1952) qui remporta 8 Oscars et 3 Golden Globe Awards. Sa réputation ne monta au sommet qu’à partir des années 2000 (numéro 1 dans la liste des Greatest Movie Musicals d’AFI, numéro 10 puis 5 dans la liste de 2007 des plus grands films américains, enfin sélectionné parmi 25 films pour leur préservation dans le National Film Registry par l’United States Library of Congress. Depuis lors, le film est régulièrement primé dans divers classements aux USA et en Europe.
L’histoire se situe dans les années 20, au moment du passage du cinéma muet au cinéma parlant (les « talkies » dans le jargon de l’époque). Comden et Green s’inspirent de l’histoire vraie de l’acteur John Gilbert, dont la carrière s’arrêta net au passage au cinéma parlant.
Lors d’un voyage, François Truffaut raconta aux acteurs du film qu’il s’agissait de son film préféré et qu’il en connaissait chaque plan ; il s’en est inspiré pour La Nuit américaine. Bertrand Tavernier estima qu’il s’agissait de « la comédie musicale la plus parfaite ». Alain Resnais était également un grand admirateur du film. Référence est faite au film dans de nombreuses productions contemporaines, telles que Babylon, en 2022, Downton Abbey, en 2022, The Artist en 2011, La La Land en 2016, sans parler d’Orange Mécanique, en 1971.
Mentionnons enfin que la mésaventure qui manque de frapper Gene Kelly dans le film (le passage au parlant) n’a pas manqué de le frapper pour de bon dans la réalité, puisque Kelly a été quasiment évincé d’Hollywood quand la mode des claquettes (la tap dance, fusion de la gigue irlandaise et de la shuffle des esclaves africains) aura disparu.
Et maintenant, bonne projection, et on se retrouve après le film.
Commentaire
Chantons sous la pluie est un film générateur d’une bonne humeur et d’un plaisir de tous les instants, un film qui alterne esprit coquin et fond mélancolique avec une suprême élégance, mais ne serait-il qu’un pur divertissement ? Un divertissement simpliste comme croit pouvoir l’exposer cette pauvre Lina Lamont : « If we bring a little joy into your humdrum lives, we feel as though our hard work ain’t been in vain for nothing” (dans la version française “Si nous mettons quelque joie dans vos humbles et mornes vies, la peine que nous nous sommes donnée n’a pas été faite en vain pour rien du tout ») ? Certainement pas. C’est pour ainsi dire « en passant » que Chantons sous la pluie expose divers sujets dont nous avons recensé quelques-uns. Le ton général du film est de façon évidente la dérision, voire la satire, un mélange de légèreté et d’acuité qui s’exerce sur toute une série de thèmes. L’Amérique savait encore se moquer d’elle-même…
Le film développe une dérision salutaire d’un ensemble de comportements que nous pouvons résumer sous le titre du règne de l’apparence, de la fausseté, du mensonge.
L’industrie du spectacle est le lieu d’expérimentation de ces comportements, qui tendent à envahir ensuite l’ensemble de la vie sociale.
Dans la scène de la première du film The Royal Rascal (le vaurien royal), qui est manifestement un navet parmi d’autres, nous assistons aux attitudes suivantes :
- Les annonces grandiloquentes, qui se complaisent dans un superlatif ininterrompu, ingrédient de base du discours publicitaire (on nous proclame que la vedette est « une inspiration pour les jeunes du monde entier »),
- Les hurlements hystériques de la foule, masse de fans surexcités,
- Les vedettes imbues d’elles-mêmes, arborant des tenues vestimentaires dont la prétention tombe dans la caricature,
- La curiosité artificiellement entretenue pour leur vie privée,
- La simulation de couples d’acteurs passionnément amoureux, même si la durée de vie de leur passion est minimale (la présentatrice précise bien que telle actrice arrive « au bras de son nouveau mari » et que tel couple « est marié depuis déjà deux mois et toujours heureux comme au premier jour ».
- Dans cet univers de fausseté (on dit fake à présent), Don Lockwood se laisse lui aussi aller à une description totalement mensongère de sa biographie, avec des flash-back qui viennent démentir son récit de la façon la plus dérisoire.
- Le mensonge par l’image d’un bonheur obligatoire : le jeu des acteurs consiste à montrer un visage ultra-souriant dès l’instant où une prise de vue s’annonce : c’est le sourire obligatoire. Le sujet filmé ou photographié doit affirmer qu’il est heureux : encore plus que d’autres, car les vedettes et les célébrités personnifient ce bonheur. On se rappellera que dans l’histoire de la photographie, jusqu’aux premières années du vingtième siècle, les sujets ont pendant longtemps tenté de se montrer impassibles, voire indifférents, ou encore exprimant une sorte de dignité et de solennité bourgeoises. Le portrait photographique était l’héritier du portrait en peinture. Il ne serait venu à l’idée de personne d’arborer un sourire (ou rire) ressenti comme vulgaire. En témoignent encore aujourd’hui les portraits à l’ancienne réalisés par le célèbre Studio Harcourt. Ce n’est que dans l’après-guerre, pendant la montée du monde de la consommation et donc de la promotion du consommateur, que l’image obligatoire du bonheur s’est progressivement généralisée, avec la masse de clichés réalisés désormais par les particuliers eux-mêmes. Phénomène tardif en Europe, plus précoce aux Etats-Unis.
- Et, pour finir, le thème central du doublage vocal (celui de Lina Lamont par Kathy Selden) est le mensonge sur lequel repose toute l’intrigue.
Cette masse de mensonges répond bien sûr à une seule motivation : l’intérêt. Autrement dit, l’argent. Alors qu’il n’est qu’un obscur figurant, Don n’intéresse pas Lina, qui l’écarte de son champ de vision. Mais dès que R. F. Simpson lui propose un rôle de premier plan, voici Lina qui s’affaire autour de lui, simulant de l’amour.
Mais l’amour, justement, comment se situe-t-il par rapport à cet environnement ? Celui que Don, pourtant lui-même très imbibé de cette industrie du faux, éprouve pour Kathy ? Comment l’histoire d’amour entre Don et Kathy s’insère-t-elle dans l’environnement que relate le film ? On peut bien sûr rapporter le personnage de Kathy au cliché de la jeune ingénue et celui de Don au séducteur machinal soudainement touché par la grâce, mais cette assimilation à des clichés n’apporterait pas grand-chose. Le fait est que si les deux personnages se situent eux aussi dans la perspective d’une réussite professionnelle et sociale dans le show business, ils sont également ceux (sans oublier Cosmo / Edmond) qui ne se réduisent pas à cela et qui éprouvent le besoin de s’en distancier. Kathy a de l’amour-propre et ne se plie pas à n’importe quoi, elle ne renonce pas à ce que George Orwell avait appelé à la même époque la common decency, elle n’est pas une personne simplement intégrée. Devant cet exemple d’indiscipline, Don se désolidarise également de la poursuite inconditionnelle du succès et prend conscience des limites de son art. Tomber amoureux s’avère alors indissociable de cette qualité subjective.
Prolongements…
Le monde du paraître, l’industrie de l’apparence. Ce qui est dépeint, c’est justement la sphère de l’entertainment, et plus précisément l’usine à spectacle qu’était, et qu’est encore Hollywood. Sujet traité avec un esprit de dérision constant. Le film commence par la première du film muet The Royal Rascal (Le royal vaurien), et nous montre les annonces grandiloquentes typiquement américaines, truffées de superlatifs, hurlements de la foule des fans au bord de la crise nerveuse, les vedettes imbues d’elles-mêmes et exhibant les signes matériels de leur fortune. Grimaces stéréotypées de Zelda Zanders (jouée par Rita Moreno). Les actrices arrivent au bras « de leur nouveau mari », comme on parle d’un nouveau manteau de fourrure. Comme le proclame la journaliste : « mariés depuis deux mois et toujours heureux comme au premier jour ! ». Le pauvre Cosmo, pas assez glamour, n’intéresse personne. L’arrivée du couple Don Lockwood / Lina Lamont est acclamée comme celle d’un couple réel : l’image du couple n’est qu’un mensonge intéressé. L’image compte davantage que le réel. « Une inspiration pour les jeunes du monde entier », proclame l’imbécile journaliste, qui quémande un scoop sur leur vie personnelle. Don répond en se bornant à la coopération purement professionnelle des deux, et en rappelant l’importance de son ami Cosmo. Mais, ces rectifications une fois faites, il sombre lui-même dans le mensonge en narrant une biographie totalement fausse, dans laquelle l’image vient sans cesse démentir la prétention des propos : « Dignity, always dignity » (chanson Fit as a fiddle, En forme comme un violon). On retrouve d’ailleurs le même procédé (une image et un son discrépants) dans une répétition pour le Dueling Cavalier (Le duelliste chevaleresque) où Don et Lina semblent se courtiser alors qu’ils ne cessent de se jeter les pires propos au visage (tout ça accompagné au piano d’un air extrait du Don Giovanni de Mozart, acte I, scène 20, quatuor Leporello, Don Ottavio, Donna Anna et Donna Elvira). Bref, le film nous montre un monde du spectacle totalement factice et trompeur.
L’opposition muet / parlant. La qualité très douteuse des films muets évoqués témoigne du fait qu’Hollywood était une usine à divertissements produits en série dès ses débuts, et qu’il n’existe pas d’époque dorée et plus artisanale que la suite. La technique commerciale du remake, par exemple, est aussi vieille que le cinéma lui-même. Comme le dit Kathy (sauf qu’elle reviendra dessus par amour pour Don), « si tu en as vu un, tu les as tous vus ». Le passage au parlant, quoi qu’en dise Charlie Chaplin, n’est donc pas nécessairement une chute de qualité car les critères de production restent les mêmes. Pour la petite histoire : Chaplin assista à la première du film et en fut ravi. Le succès du film fut immédiat, sauf en France… Depuis 1963, date de la sortie de la version originale dans l’hexagone, le film a finalement trouvé son public.
Les parades. Les « parades » musicales qui défilent dès l’aube du cinéma parlant étaient d’un kitsch inégalable. Beautiful girl en est un exemple paradigmatique, finissant sur des spots commerciaux. Broadway Melody traite le même thème, mais sur un ton ambivalent : hostilité vis-vis du jeune débutant de l’environnement établi, préférence de la séduisante Cyd Charisse pour l’horrible mafieux, vérolé et fortuné, mais aussi réconciliation finale de Don avec cet environnement clinquant et stéréotypé.
Le culte du succès. Lorsqu’il n’était encore qu’un obscur figurant, Don ne suscitait pas l’attention de Lina, qui détournait avec mépris le regard devant cet individu insignifiant. Lorsque la promotion de Don en acteur principal est annoncée, Lina change d’attitude et ne cesse plus de courtiser son collègue : à Hollywood (comme partout ailleurs), on ne compte qu’en raison de son succès social. Et les décisions prises, le choix du sujet et le choix des acteurs, ne sont orientées que par le besoin de tenir compte de la concurrence et par l’espoir d’un profit assuré, et non en raison de critères esthétiques. Dans cette jungle, il a fallu des personnages talentueux et combattifs pour réaliser malgré tout des films de grande qualité.
S’exprimer en-dehors du spectacle. L’accès à une parole subjective ne va pas de soi. Une scène reproduit cette difficulté : c’est le charmant duo You were meant for me (Vous m’étiez destinée). Pour révéler ses sentiments intimes, Don a besoin d’un décor de fiction : « this is the proper setting », voici le décor qui convient. Une fois qu’on a touché à la fiction, comment s’en passer ? Pour dire à Kathy ce qui est extérieur au spectacle, Don recourt néanmoins aux moyens de mise en scène de celui-ci.
Un monde procédurier. La revanche prise par Lina à la fin du film, son projet de déposséder le producteur de son pouvoir de décision, illustre bien le pouvoir des avocats américains, qu’elle a consultés pour interpréter son contrat de travail, pour plaider le préjudice moral et pour menacer d’aller en justice. Tout menace toujours de finir devant les tribunaux et d’en extorquer des avantages.
La bonne conscience de la médiocrité. Les scénaristes ont confié au personnage le plus mentalement limité du film, Lina Lamont, le soin d’énoncer ce que l’on peut considérer comme le théorème de base de l’industrie du divertissement : « If we bring a little joy into your humdrum lives, we feel as though our hard work ain’t been in vain for nothing” (dans la version française “Si nous mettons quelque joie dans vos humbles et mornes vies, la peine que nous nous sommes donnée n’a pas été faite en vain pour rien du tout »). La vie des gens est présumée insignifiante, et le rôle du spectacle est de compenser cette misère par les illusions et les apparences factices qu’il dispense. C’est là l’unique vocation du spectacle. Il n’a pas à éveiller ni à instruire les spectateurs, mais à les endormir en les berçant d’illusion.
Debbie Reynolds se retrouve les pieds en sang et désespérée, c’est Fred Astaire, présent sur un plateau voisin, qui vient l’aider. Pour l’anecdote toujours, Debbie Reynolds était la mère de l’actrice Carrie Fisher (Princesse Leïa dans la Guerre des Étoiles) et elle mourut d’un AVC le lendemain du décès de sa fille en 2016.
Le personnage onirique joué et dansé par la belle Cyd Charisse est inspiré des actrices du muet alors célèbres Louise Brooks et Pola Negri.
La leçon de prononciation administrée par la coach Phoebe Dinsmore à l’irrécupérable Lina Lamont évoque irrésistiblement la célèbre séance The rain in Spain stays mainly in the plain dans My Fair Lady, interprétée au cinéma par Rex Harrison et Audrey Hepburn. Alan Jay Lerner écrivit le script de cette comédie musicale en 1956, quatre ans après Chantons sous la pluie.
Le personnage de Cosmo Brown est inspiré du pianiste et acteur Oscar Levant, qu’on peut voir dans Un Américain à Paris.
Petite anecdote : dans le film, Debbie Reynolds double Jean Hagen (Lina Lamont) mais en réalité c’est Hagen qui double Reynolds dans certaines scènes car l’accent texan de Reynolds déplaisait à Stanley Donen.
La chanson Singin’ in the rain a été composée par Arthur Fried en 1929, elle a comme d’autres été reprise dans le film que nous projetons, écrit et tourné en 1952 et la comédie musicale (sur scène) n’a été réalisée qu’en 1983, longtemps après le film.
Le film a bien été conçu de toutes pièces en 1952, il n’avait rien d’un remake.
La chanson avait toutefois été reprise dans un film intitulé Hollywood chante et danse (The Hollywood Revue) de Charles Reisner en 1929 dont Wikipedia ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Hollywood_chante_et_danse) note le résumé suivant :
« Avec l’arrivée du cinéma parlant et les prémices du Technicolor les grandes compagnies cinématographiques hollywoodiennes décidèrent de mettre en chantier ce que l’on n’appelait pas encore « superproduction ». De fait il s’agissait de réunir dans un même film l’ensemble des acteurs composant leurs écuries respectives. Ainsi la Warner Bros. fit-elle réaliser son The Show of Shows tandis que de son côté La Métro sortait Hollywood chante et danse rassemblant ses comédiens parmi lesquels naturellement Stan Laurel et Oliver Hardy. Pas de scénario dans ce fil qui est composé d’une succession de numéros musicaux pour lesquels les acteurs furent invités à faire un peu le contraire de ce qu’ils faisaient d’habitude à l’écran. Laurel et Hardy s’en tirent plutôt bien en jouant les présentateurs magiciens ».
Ses acteurs principaux sont presque tous des inconnus pour le public contemporain, à l’exception de Joan Crawford.
Le cinéma français n’était pas en retard sur le cinéma américain puisqu’en 1929, René Clair utilise le parlant pour sa comédie musicale Sous les toits de Paris avec en tête de distribution Albert Préjean.
Technique de danse et chorégraphie dans le film. Possibilité de reprendre le paragraphe suivant : Wikipédia remarque à juste titre : « Chantons sous la pluie est parfois considéré comme une illustration de la fin de cette époque : son numéro le plus remarquable n’est pas le grand ballet d’un quart d’heure avec force décors et figurants, mais bien deux numéros en solo, Make ‘em Laugh et Singin’ in the Rain, différents des blockbusters qui prennent toute la place dans les années 1950 et 1960. En dehors du court pas de deux entre Gene Kelly et Cyd Charisse, il ne comporte pas de duo mémorable sur le modèle de Fred Astaire et Ginger Rogers. Il s’éloigne donc des normes du genre, finalement aussi fatiguées que celles du cinéma muet à l’époque où se déroule l’œuvre ».
JPB