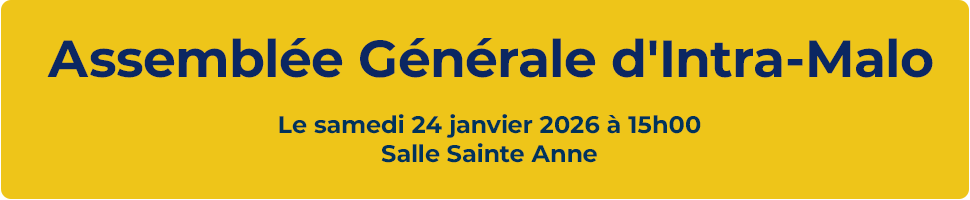Parlons maintenant de technique et de matériel cinématographique :
S’il n’y avait pas eu des ingénieurs très savants au dix-neuvième siècle et grâce à l’essor technologique et industriel de ces années magiques, nous n’aurions peut-être jamais connu Charlie Chaplin et tous les artistes qui ont suivis !
Le cinéma c’est une ouverture sur le monde et c’est ce qui a permis aux femmes et aux hommes de pouvoir communiquer tous ensemble avec des langues différentes !
L’idée première, qui remonte à Léonard de Vinci, a été de pouvoir reproduire la réalité, le temps présent, pouvoir la stocker, puis la restituer !
Au dix-septième siècle on invente déjà la lanterne magique, c’est Anatole Kircher à qui l’on doit l’art de la lumière et des ombres. Tiens cela me rappelle quelque chose, mais oui notre collègue Christophe et son Théâtre des Ombres qui anime encore aujourd’hui cet art dans Intramuros !
S’ensuit l’invention de la photographie qui permet déjà de fixer une image sur un papier ce qui en soi est déjà magique !
Mais reste le chapitre, reproduire le mouvement, objectif même du cinématographe !
Je vous rappelle le principe : on projette une succession de photographies fixes sur un écran au rythme de 24 images par seconde (ce qui se rapproche le plus du mouvement naturel) et grâce au phénomène physique de la persistance rétinienne cela donne l’illusion du mouvement, magique non !
A partir de là tout un tas d’inventions les plus folles apparaissent au dix-neuvième siècle et au début du vingtième siècle !
L’histoire retiendra les Frères Lumière concepteurs de ce principe comme d’ailleurs d’autres inventeurs un peu partout dans le monde avec des systèmes tous différents.
Mais finalement c’est l’invention des Frères Lumière qui démocratisera le « produit cinématographique » à travers le monde !
Ils déposeront, le 13 février 1895, le brevet du « cinématographe ».
A cette époque on ne sait pas encore si cette découverte aurait un avenir commercial, la suite vous la connaissez aussi bien que moi.
Mais il manquait quand même une chose essentielle au cinéma de ces années-là, le « son ».
En 1896 le Français Auguste Baron expérimente un mélange de cinématographe et de phonographe permettant d’avoir les premiers films parlants.
Grâce à la physique et la chimie on crée un film pour le cinéma à base de gélatine et on lui offre un format, le 35mm est retenu mondialement, il sera d’abord en noir et blanc et bien plus tard en couleur.
Les bases du cinéma sont posées en quelques années et c’est la France qui devient la première productrice de films et aussi la première exportatrice de la nouvelle industrie cinématographique.
Plusieurs sociétés apparaissent dont les plus connues sont Pathé et la Gaumont.
Les frères Pathé inventent un format de pellicule moins large, ce sera le format 17,5mm !
Ce format permet de fabriquer des caméras et des projecteurs moins encombrants et qui permettra de démocratiser encore plus le cinéma et de pouvoir l’amener dans toutes les régions de France et de Navarre.
Cela va entrainer l’apparition des projections rurales, de projectionnistes itinérants. On n’a pas encore le son mais on fait appel à des musiciens, surtout des pianistes qui accompagnent chaque séance de cinéma.
Le mot projectionniste est un terme toujours employé de nos jours, en Bretagne on le nomme « termajes » qui veut dire lanterne magique en phonétique.
Le format 17,5mm ne sera finalement pas standardisé, il sera remplacé pendant la 2ème guerre mondiale par le format 16mm, c’est les Américains au sortir de la 2ème guerre mondiale qui laisseront à la France beaucoup de matériel cinématographique et plusieurs copies de films qui formeront l’ossature des premières cinémathèques en 16mm, apparaitront les ciné-clubs d’obédience laïque et chrétienne.
D’autre formats encore plus petits ainsi que des petites caméras et mini projecteurs apparaitront dans les années 1950 qui permettront aux particuliers de rentrer dans les maisons et de faire leur propre cinéma !
Et lors de cette projection, vous aurez découvert comment les gens voyaient les films dans ces années-là.
Le projecteur 16mm sonore que nous avons utilisé pour la projection est assez récent. Il date des années 1990, il est doté d’un amplificateur transistorisé et de conception japonaise. Cela ne vous étonnera sûrement pas, il est assez simple à utiliser et il possède un couloir libre pour mettre en place la pellicule.
Par contre l’autre projecteur 16mm, présenté près de l’écran, est un appareil Français inventé par l’ingénieur André Debrie. Il date des années 1940, il fonctionne toujours mais il est plus difficile à manier.
Ce projecteur fournit aussi du son et permet de projeter une grande image lui aussi.
Le procédé du son employé sur ces 2 modèles de projecteur n’est pas celui des bandes magnétiques bien connu des années 1960, on utilise un côté du film non perforé pour y adjoindre une bande sonore analogique insérée dans la pellicule ou l’on retrouve le diagramme d’une courbe sonore.
Une lampe spéciale dans le projecteur va décrypter et restituer le son.
On appelle cette technique « la lecture optique ».
L’intérêt de cette technique est que la bande sonore ne touche jamais la lampe, il n’y a pas d’usure par frottement comme avec des têtes magnétiques.
C’est ce système qui est employé sur les bobines et les projecteurs 35mm de nos anciennes salles de cinéma et qui ont rendu, pendant plus de 50 ans, de bons et loyaux services.
Vous avez pu découvrir des explications de l’entreprise André Debrie sur l’une des planches exposées dans la salle sainte-Anne.
Nous vous remercions de votre attention et sommes prêts à répondre à toutes vos questions que ce soit sur Charlie Chaplin ou sur la technique employée au cinéma de ces années-là.
MF